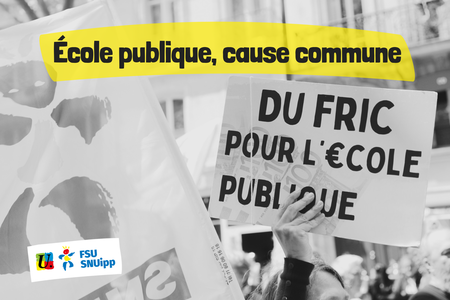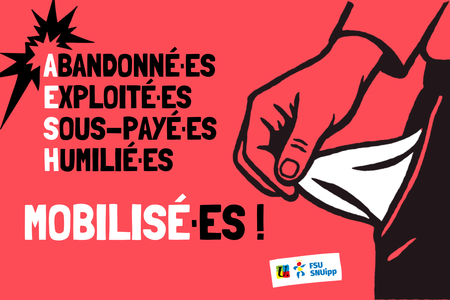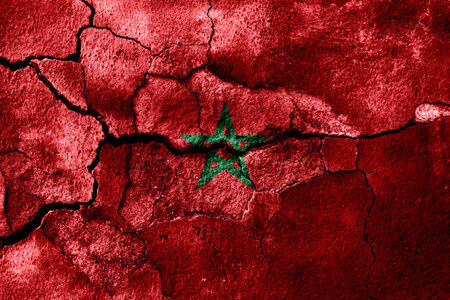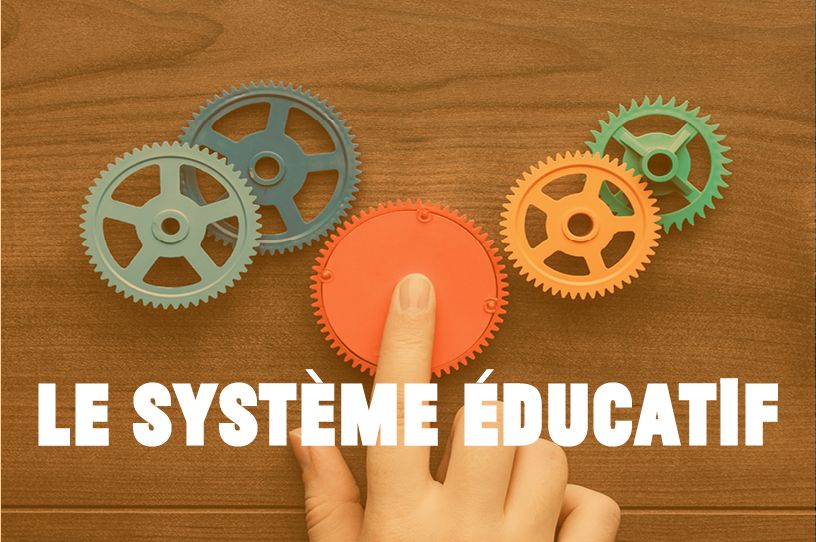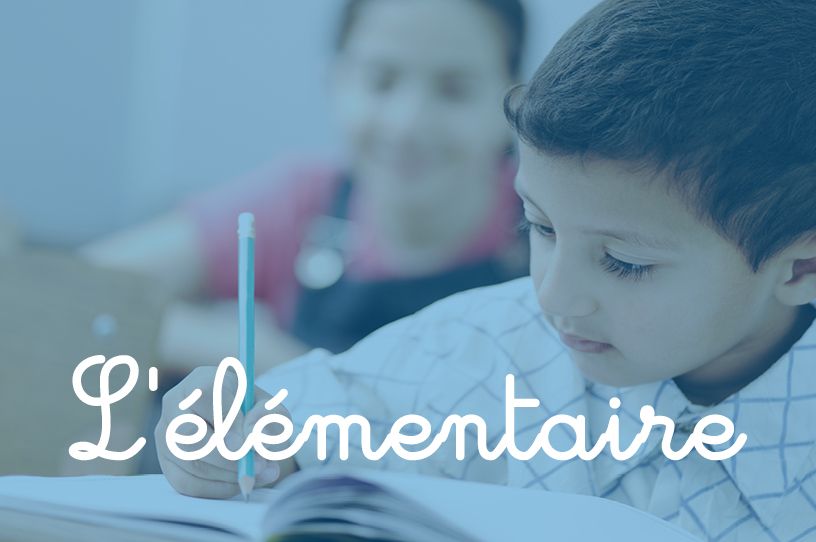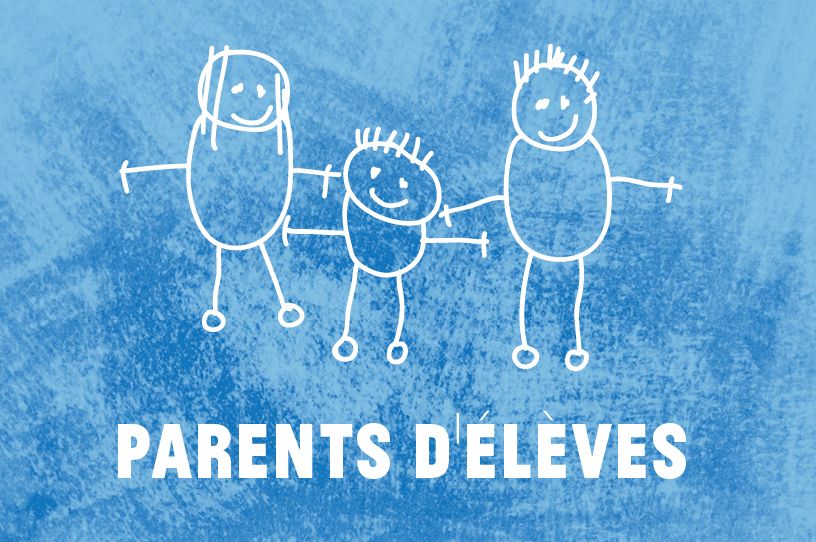“La politique d’éducation prioritaire ne peut être que systémique, pédagogique et collective”
Mis à jour le 21.03.25
min de lecture
Grande interview de Michèle Coulon, membre du collectif Langevin Wallon avec Marc Bablet et Fabienne Fédérini.
Michèle Coulon ets membre du collectif Langevin Wallon avec Marc Bablet et Fabienne Fédérini. Ils publient « L’éducation prioritaire, une politique féconde pour le système éducatif » aux éditions Croquant.

QUELS CONSTATS FAITES-VOUS AU SUJET DE LA POLITIQUE D’ÉDUCATION PRIORITAIRE ?
La politique me-née depuis 2017 a tourné le dos à la refondation de l’éducation prioritaire, initiée entre 2013 et 2017, en privilégiant une démarche extrêmement verticale. La substitution, dès 2017, du dispositif « plus de maîtres que de classes » par le dédoublement des classes de CP, CE1 puis GS en est un exemple emblématique. À une mesure qui favorisait le travail collectif des enseignants, l’observation des élèves, l’analyse conjointe des obstacles rencontrés pour organiser et construire une pédagogie proche des besoins des élèves, a été substituée une organisation rigidifiée imposant méthodes et pratiques pédagogiques. La scolarisation des moins de 3 ans a été affaiblie, le développement d’expérimentations favorisant la mixité sociale mis sur pause. La question sociale entendue comme l’analyse du processus liant résultats scolaires et milieu socio-économique a été effacée au profit d’une approche largement appuyée sur les neurosciences, une manière de faire de la réussite ou de l’échec scolaire une responsabilité individuelle.
QUELLE PLACE ONT LES ÉLÈVES DES MILIEUX POPULAIRES DANS L’ÉCOLE ?
L’école s'appuie sur des compétences et des comportements très largement construits par les élèves à l’extérieur de l’école qui vont faciliter leur compréhension du sens des activités proposées ; elle fonctionne donc plutôt bien pour les enfants des classes moyennes et supérieures. Les enfants des milieux populaires, plus démunis face à cette culture scolaire, sont en difficulté et le plus souvent perçus et décrits par leurs manques - ce qu’ils ne sont pas, ne comprennent pas - , ce qui ne dit rien de la manière dont ils appréhendent l’école, dont ils la perçoivent et comment elle agit sur eux. Cette incompréhension mutuelle entraîne difficulté d’enseignement d’un côté et difficulté d'apprentissage de l’autre et une place difficile à trouver pour les élèves des milieux populaires. Les évaluations nationales et internationales nous le rappellent régulièrement en pointant le poids énorme de l’origine sociale sur le destin scolaire des élèves en France.
“Se nourrir des travaux de recherche pertinents pour comprendre les enfants et les familles de milieux populaires.”
QUELS SERAIENT LES GRANDS PRINCIPES D’UNE POLITIQUE D’ÉDUCATION PRIORITAIRE ?
Une politique sérieuse de lutte contre les effets de la ségrégation sociale et scolaire ne se résume pas à quelques dispositions ou dispositifs. La politique d’éducation prioritaire ne peut être que systémique, pédagogique et collective. C’est l’esprit du référentiel de l’éducation prioritaire de 2013 : se concentrer sur le quotidien de la classe, les pratiques pédagogiques individuelles mais aussi d’équipes, donner du temps pour le travail collectif et la formation, tout en agissant utilement avec les familles et les partenaires. Cela demande un pilotage inscrit dans la continuité afin d’éviter les changements de caps successifs. Une telle politique doit se nourrir des travaux de recherche pertinents pour comprendre les enfants et les familles de milieux populaires, s’appuyer sur le savoir acquis depuis maintenant plus de 40 ans.
L’ÉDUCATION PRIORITAIRE EST-ELLE ENCORE INDISPENSABLE ?
La géographie urbaine organise des concentrations de populations socialement précarisées qui rendent nécessaire la politique d’éducation prioritaire. La ségrégation sociale et scolaire est toujours aussi prégnante, renforcée par le dualisme vivace public/privé. La mixité sociale, quand elle existe, ne suffit pas à elle seule à rétablir une justice scolaire, mais son absence renforce les obstacles que peuvent rencontrer les élèves pour réussir et prendre la place qui leur est due dans l’école et la société. L’enjeu est que cette politique ne soit pas un « alibi social » mais qu’au contraire les pratiques, organisations, recherches et analyses qu’elle a suscitées puissent inspirer le système éducatif dans son ensemble. Contribuer à ce qu’elle soit une politique féconde pour le système éducatif est un des objectifs du travail du collectif Langevin Wallon.