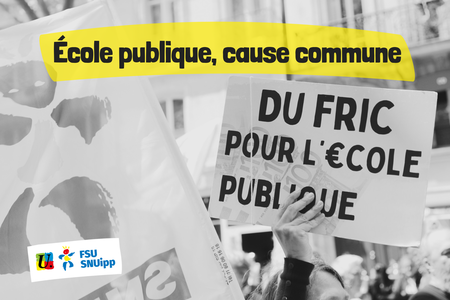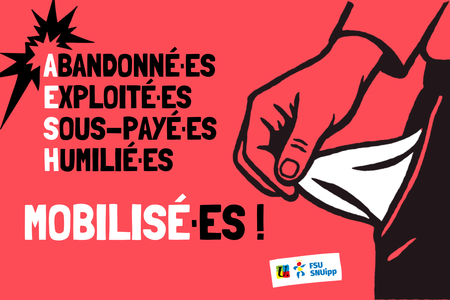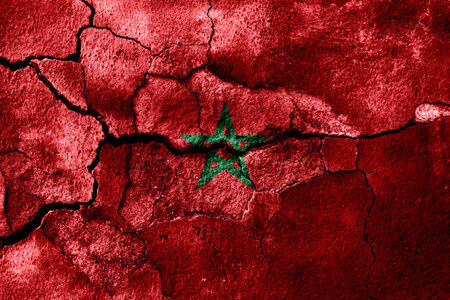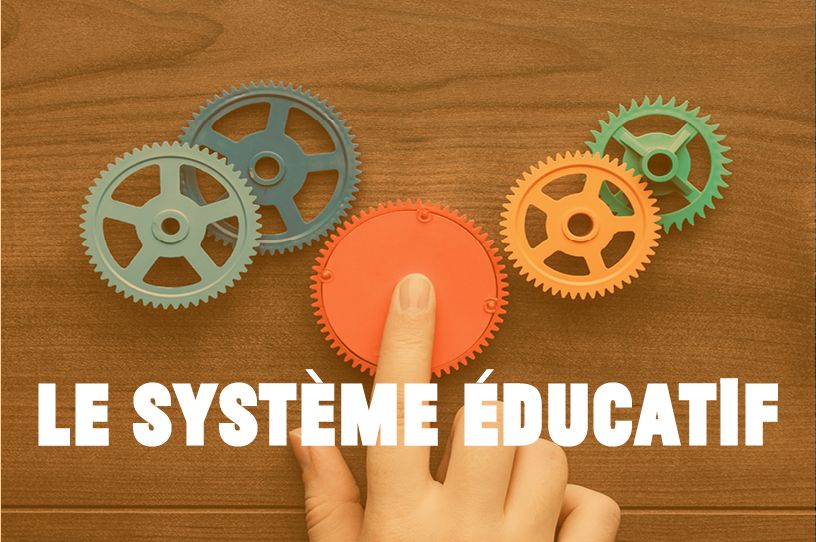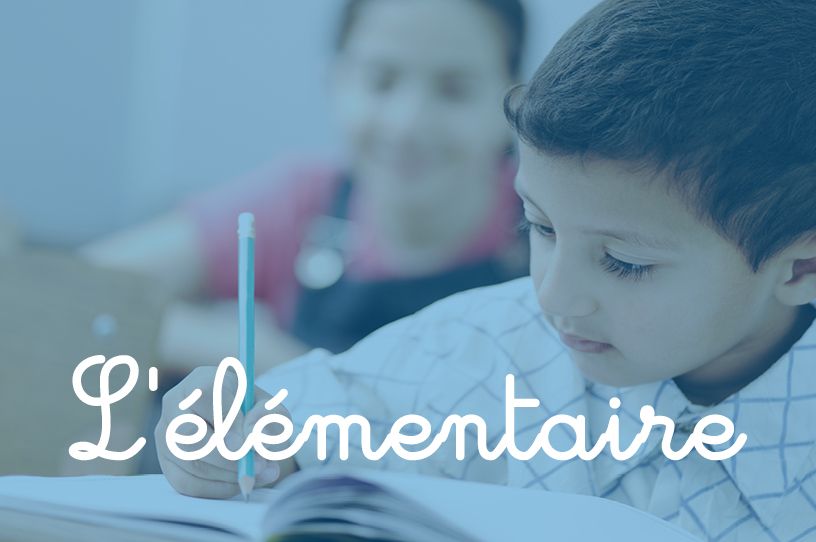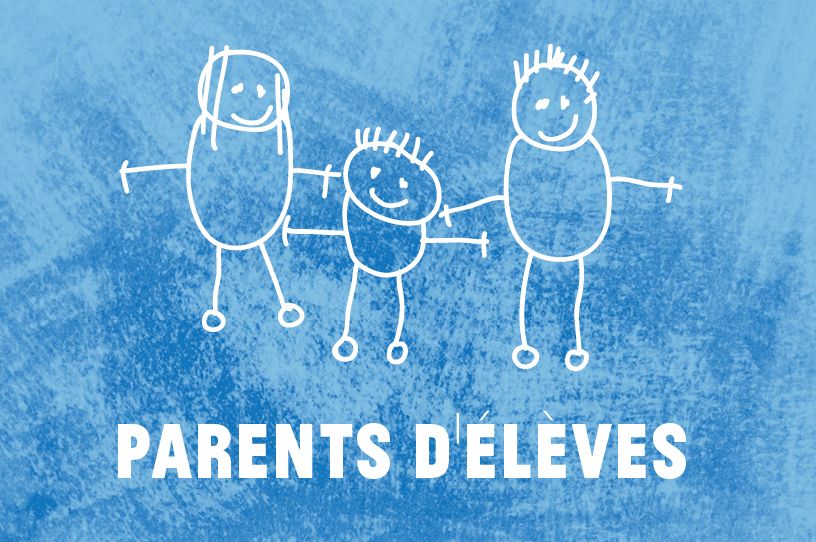Éduquer contre tous les racismes
Mis à jour le 21.03.25
min de lecture
L’école a un rôle essentiel mais complexe à jouer dans la lutte contre les discriminations.
L’école a un rôle essentiel mais complexe à jouer pour prendre toute sa part dans la lutte contre les discriminations et les violences liées aux origines présumées ou aux croyances dans une période où les actes racistes et antisémites sont en forte recrudescence.
Si l’éducation contre le racisme et l’antisémitisme fait officiellement partie des missions assignées à l’école, cet enseignement s’avère délicat à mettre en place. Ceci d’autant que les ambitions des nouveaux programmes de l'enseignement moral et civique (EMC) sont en net recul par rapport à ceux de 2015 (page 16). Mais l’EMC ne constitue pas la seule entrée pour éduquer contre le racisme. Cela relève aussi d’une pédagogie de projet, d’apprentissages interdisciplinaires et d’une vigilance quasi-permanente en travaillant sur les postures enseignantes. Construire des actions pédagogiques autour de la lutte contre les discriminations liées à l’origine, à la culture ou à la religion des populations n’a jamais semblé plus urgent : 1 676 actes antisémites ont été comptabilisés en France en 2023, soit quatre fois plus qu’en 2022 et 1 242 actes racistes ont été recensés lors du seul dernier trimestre 2023 (*Rapport 2023 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, Commission nationale consultative des droits de l’homme).
Le calendrier évènementiel peut constituer une porte d’entrée pour aborder les questions du racisme et de l’antisémitisme (semaine de l’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, 80e anniversaire de libération des camps d’extermination nazis…). Il s’agit pour les PE de tenter de rendre tous les élèves acteurs et actrices de l’apprendre et du vivre ensemble par une approche interdisciplinaire et des gestes professionnels annihilant ces discriminations dans et hors la classe. Il convient également d’interroger les stéréotypes dans les choix didactiques et pédagogiques.
“ L’école ne peut faire abstraction des processus de racialisation et du racisme vécu par
les élèves.’’
LA LITTÉRATURE JEUNESSE EN QUESTION
La sociologue Solène Brun souligne le rôle essentiel du système scolaire dans la lutte contre tous les préjugés, notamment contre le développement des thèses racistes et antisémites (page 19). « L’école a notamment un rôle à jouer dans les contenus étudiés, par exemple, dans le fait de ne pas reproduire l’invisibilisation historique des groupes dominés dans la manière dont l’histoire, les sciences, etc., sont apprises et transmises », indique-t-elle. « L’école ne peut faire abstraction des processus de racialisation et du racisme vécu par les élèves. C’est pourquoi il est important que les enseignants puissent bénéficier des temps et des espaces collectifs de discussion, de réflexion et de formation afin de traiter ces questions complexes », précise Solène Brun.
La littérature jeunesse pourrait parfois également être un support intéressant pour décrypter la mécanique du racisme et les rapports de domination qui la sous-tendent. La chercheuse en sciences humaines et sociales, Sarah Ghelam, considère que les albums destinés au jeune public constituent un « espace de socialisation où l’enfant va construire son identité et son rapport au monde » (page 17). Dans ces conditions, certains ouvrages qui se caractérisent par « l’absence de certains enfants, certaines pratiques et certaines expériences » vont avoir des conséquences sur les jeunes lecteurs et lectrices. « L’enfant non blanc intégrera qu’il n’est pas important, l’enfant blanc s’habituera à ce que son point de vue soit la norme », soutient la chercheuse, ajoutant qu’il existe quelques « albums antiracistes, à l’intérieur duquel les rapports sociaux de race sont questionnés ».
VISITES MÉMORIELLES EN APPUI
À Tarbes (Hautes-Pyrénées), la classe de GS de la maternelle Jacques-Prévert s’éveille à la diversité linguistique des langues d’origine parlée dans les familles. « Il existe une croyance persistante qu’il ne faut pas parler sa langue pour s’intégrer à l’école, explique Edith Payart,la maîtresse. Il a fallu déconstruire cette représentation pour donner une place à la diversité linguistique et culturelle des enfants ». Une démarche qui, selon elle, permet d’« autoriser les parents à transmettre les parcours de vie et à restaurer une légitimité à leurs langues d’origine, ce qui constitue une reconnaissance nécessaire et met sur un pied d’égalité les cultures comme les enfants » (page 17).
“Autoriser les parents à transmettre les parcours de vie et à restaurer une légitimité à leurs langues d’origine’’
Les visites scolaires sur les sites mémoriels sont également l’occasion pour les élèves d’appréhender les tragédies historiques. Ainsi, à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, la classe de CM1-CM2 de Geneviève Lerique, directrice de l’école Roumanille, a pu se rendre compte in situ des conditions de détention des internés et déporté·es du camp des Milles, antichambre d’Auschwitz (page 18). De quoi tirer au présent les leçons du passé ? « Les élèves prennent conscience que juger arbitrairement autrui peut conduire aux drames du camp des Milles. Leur façon de se comporter les uns avec les autres changent. Ils s’écoutent davantage avec empathie, collaborent de manière plus responsable. C’est encourageant même si on sait qu’on ne fait que semer des graines… ».
FOCUS : INÉGALITÉS PLURIELLES
Les mécanismes de reproduction scolaire des inégalités sociales sont bien connus de la recherche. Les inégalités de genre ont été plus récemment mises en lumière. Mais l’absence de statistiques tend à invisibiliser les discriminations subies par les élèves victimes de racisme, en particulier d’origine maghrébine et subsaharienne : concentration dans les établissements des quartiers prioritaires, refus d’inscription à l’école, orientation subie, sanctions, attentes et exigences différenciées concernant le travail réalisé en classe. Les tests internationaux Pisa révèlent qu’à milieu social comparable, l’écart entre les résultats scolaires des élèves “issus de l’immigration” et ceux des élèves “natifs” reste supérieur en France à la moyenne de l’OCDE*. Promouvoir un discours anti-raciste ne peut dispenser l’institution d’avoir à corriger les facteurs structurels de discrimination scolaire liée à la catégorisation raciale.
* « Comment l’école amplifie-t-elle les inégalités sociales et migratoires ? », Cnesco, 2016.
SOMMAIRE
- Reculs et points d'appui : S'appuyer aussi sur d'autres disciplines que l'EMC
- Instaurer une dignité culturelle : Un exemple d'éveil à la diversité linguistique dans les Hautes-Pyrénées
- 3 questions à Sarah Ghelam : "L’important est donc de penser à comment sont représentés les personnages"
- La mémoire contre l'indifférence : Interroger le présent à la lecture du passé au camp des Milles pour les CM1-CM2
- Interview de Solène Brun : “Le racisme est un rapport de domination et pas seulement une idéologie”