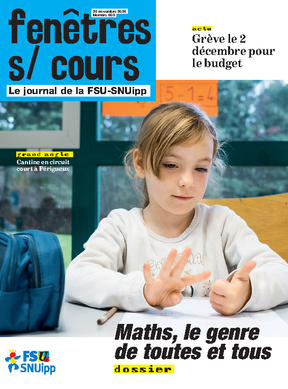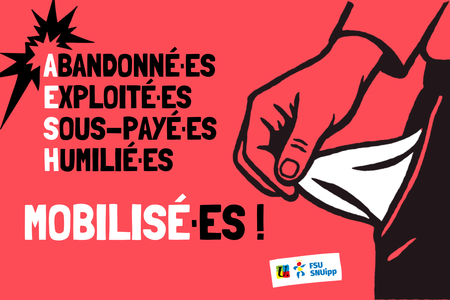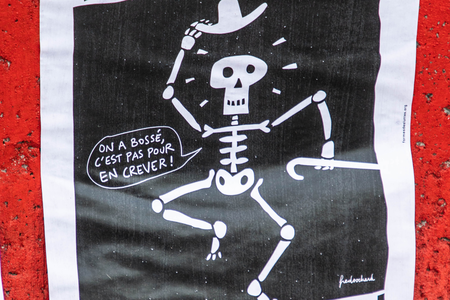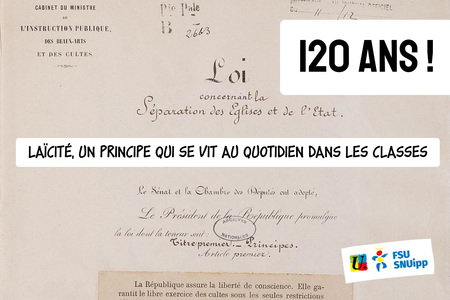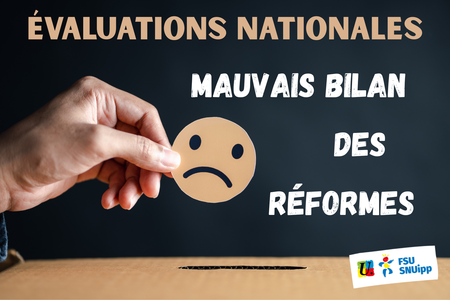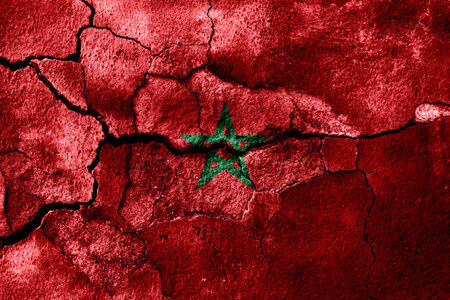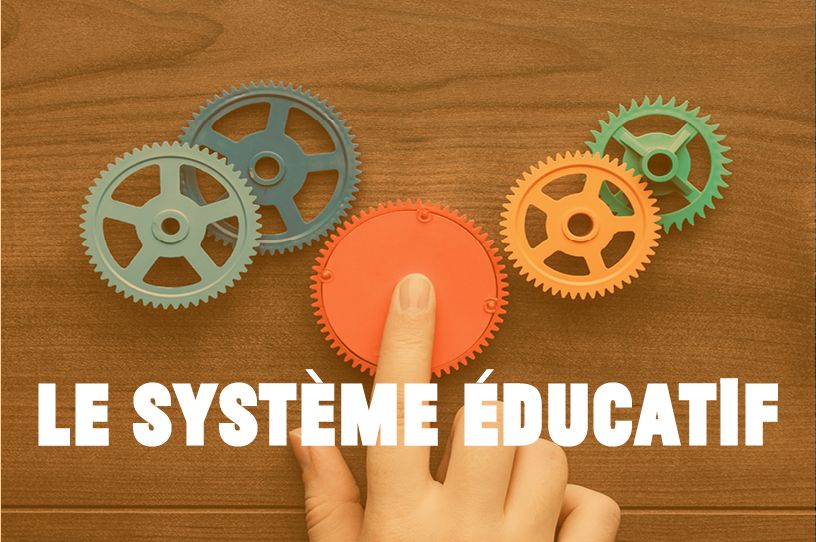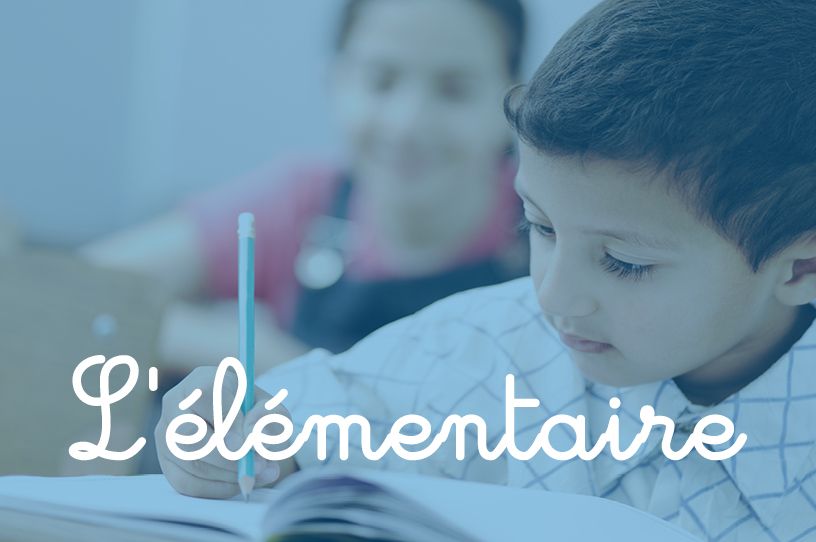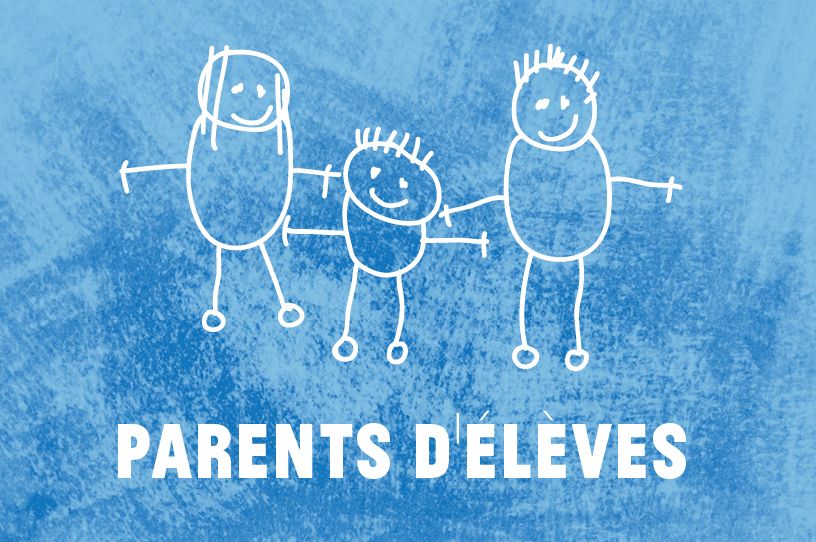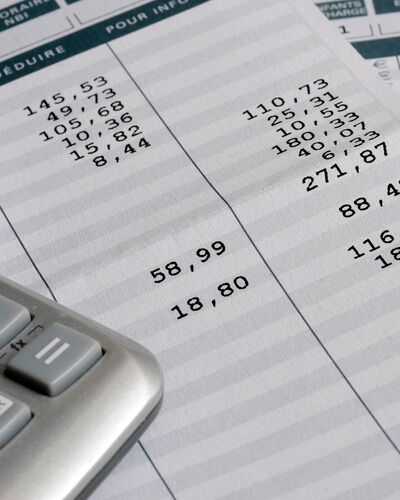“Tous les élèves n’ont pas la même conception de l’autonomie”
Mis à jour le 19.11.25
min de lecture
L’autonomie des élèves est devenue une valeur centrale de l’école. Or, tous les élèves ne sont pas égaux face à l’acquisition de cette compétence. S’appuyer entre autres sur des pratiques d’étayage permet de viser l’émancipation pour toutes et tous.
Patrick Rayou est professeur émérite en sciences de l’éducation à l’Université Paris 8. Membre du Circef-Escol. Ses recherches s’attachent à élucider la construction des inégalités d’apprentissage. Il a publié Sociologie de l’éducation, Ed Que sais-je? Troisième édition 2024, et L’autonomie des élèves. Injonctions, pratiques, inégalités, Ed PUL.

QUELLE EST LA CONCEPTION DE L’AUTONOMIE DE L’ÉCOLE ?
La vision de l’autonomie à l’école participe d’une façon de concevoir les personnes dans le monde social en général. L’autonomie est sou-vent considérée comme une compo-sante native des personnes, comme si celles-ci étaient spontanément auto-nomes et tiraient d’elles-mêmes ce qu’elles sont capables de faire. A l’école, il s’agirait de laisser le plus possible les sujets se développer librement en agissant juste sur des aspects comporte-mentaux comme bien manger, dormir ou s’éloigner des écrans. C‘est ne pas voir que les milieux participent de la construction même des sujets et qu’il existe pour certains élèves des appuis, des aides invisibles dans le milieu hors-scolaire, qui leur permettent de réussir à l’école et d’y être autonomes. Cette vision va aussi de pair avec les évolutions dans les attendus de l’école. Désormais, les élèves doivent acquérir des savoirs, mais surtout les décontextualiser, les recontextualiser dans d’autres domaines, ce qui demande une plus grande autonomie qu’autrefois.
QUELS MALENTENDUS PEUVENT SE METTRE EN PLACE ?
Tous les élèves n’ont pas la même conception de l’autonomie. Dans les milieux populaires, l’autonomie mise en avant est fonctionnelle : savoir faire ses lacets, amener les frères et sœurs à l’école, se faire à manger, se débrouiller dans la vie mais sans se faire remarquer ou poser de questions. Transposée au niveau scolaire, l’autonomie, c’est adopter un bon comportement comme se lever quand un enseignant entre ou faire ses devoirs seul et ne rien demander à personne. Or, l’autonomie recherchée à l’école est une autonomie intellectuelle très différente. Rendre compte d’un texte, conduire un raisonnement mathématique ou une production scripturale qui obéissent à des règles tacites qu’il faut s’approprier. Les enfants de milieux favorisés sont socialisés dans ce sens au quotidien. Ils n’hésitent pas à poser des questions, demander de l’aide, mais aussi sont préparés à se lancer dans des projets globaux, puis à les mettre en œuvre.
“Aujourd’hui, les élèves doivent acquérir des savoirs, mais surtout les décontextualiser, les recontextualiser dans d’autres domaines”
LES LOGIQUES DE COMPENSATION SONT-ELLES EFFICACES ?
Elles veulent combler des manques supposés, sans se poser la question de la nature de ce qu’on leur donne, ni de sa compatibilité avec leur culture d’origine. Les logiques de compensation visent à donner aux enfants la culture scolaire qu’ils n’ont pas. Mais cela occulte que la culture scolaire est souvent le prolongement de cultures présentes dans des familles qui maîtrisent les codes de l’école et qui pédagogisent la vie quotidienne. Parce que certains enfants sont préparés à la mai-son à recevoir le message scolaire, l’école tend à considérer que c’est possible en l’état pour tout le monde, que ce n’est qu’une question d’engagement et d’autonomie. Elle va alors souvent tabler sur du quantitatif plutôt que du qualitatif. Comme lors d’un redoublement où elle fait refaire à l’élève la même chose que ce qu’il n’a pas su faire mais sans essayer de voir où il en est, comment il réfléchit, et surtout comment substituer des savoirs scolaires à d’autres en prenant en compte les conflits de loyauté que cela peut engendrer.
QUELLES PISTES POUR VISER L’ÉMANCIPATION DES ÉLÈVES ?
L’émancipation est un idéal magnifique mais qui passe par des voies qui ne peuvent pas être les mêmes pour tous. C’est pourquoi l’étayage en classe est fondamental. Plutôt que de différencier à posteriori, il faudrait partir de là où en est l’élève pour l’aider en fonction de ce qu’il est capable de faire à un moment donné et vis-à vis d’un objectif à atteindre. Cela passe notamment par le maintien dans la tâche et l’acquisition de la persistance scolaire, valeur fonda-mentale à l’école mais dont sont très éloignés des enfants qui sont dans la satisfaction immédiate et se projettent peu sur le long terme. Cela passe aussi par la réduction de la difficulté à certains moments pour la rendre surmontable. Graduer ce que l’élève est capable de faire en termes de zone proximale de développement pour l’étendre ensuite le plus possible et arriver à l’émancipation visée.