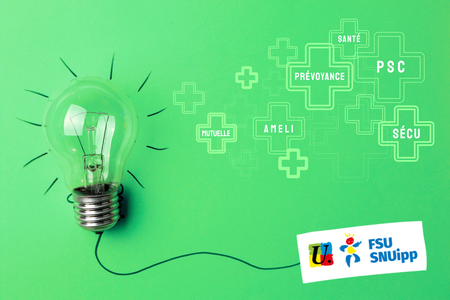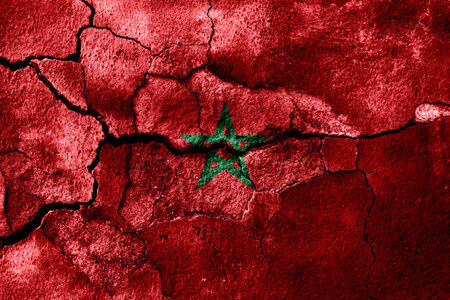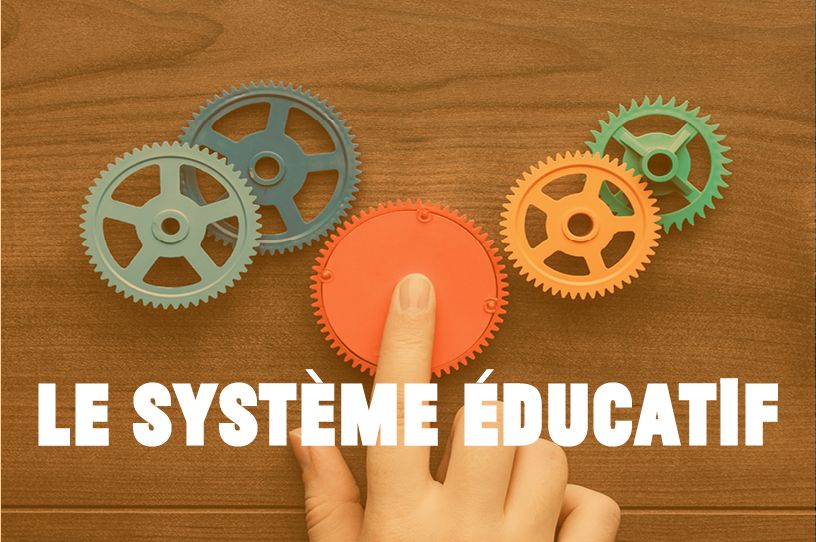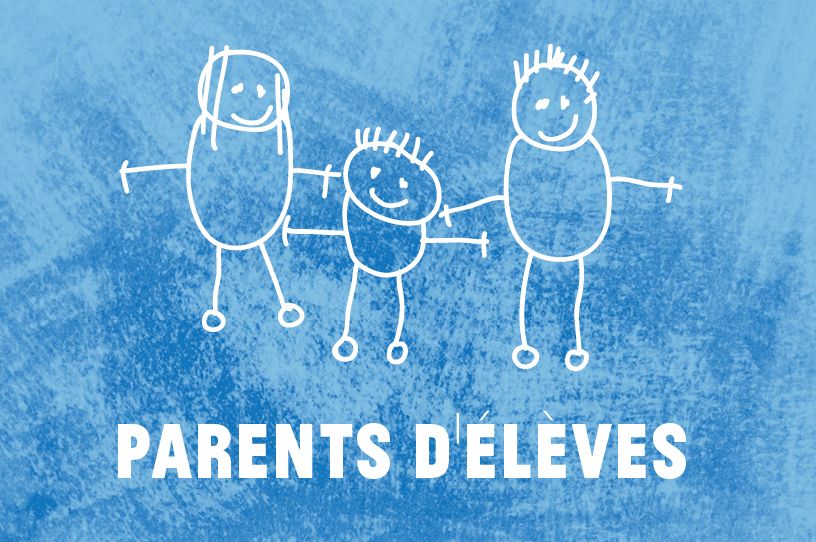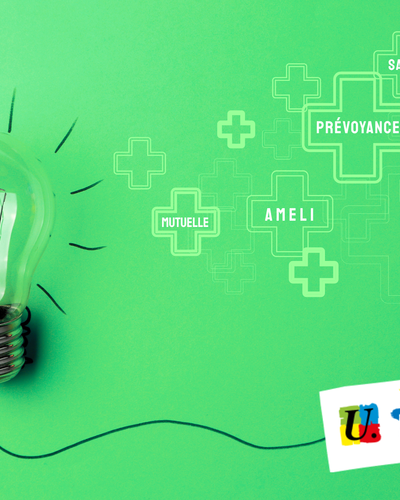“Redonner ses titres de noblesse à l’émancipation”
Mis à jour le 26.11.21
min de lecture
Pour Laurence De Cock, les réformes éducatives de Jean-Michel Blanquer mises en place dans un contexte de coercitions, opèrent une véritable « contre-démocratisation », renforçant les inégalités socialement construites et ne permettant pas une trajectoire choisie pour toutes et tous. Dans École publique et émancipation sociale, la professeure en didactique de l’histoire, retrace les jalons fondateurs de l’école publique, notamment la protection des plus humbles et une société plus juste et solidaire. L’autrice pose à son tour des principes incontournables pour que le service public d’éducation sorte des logiques de domination et soit une école de l’émancipation et de la transformation sociale.
Laurence De Cock, chercheuse en histoire et sciences de l’éducation –professeur en lycée et en didactique de l’histoire et la sociologie du curriculum à l’université Paris. Autrice Ecole publique et émancipation sociale (Edition Agone 2021).

Qu'est-ce que la crise sanitaire a révélé de l'école ?
La crise a agi comme un précipité, au sens chimique, c’est-à-dire en mettant à jour des problèmes déjà là. Elle a confirmé l’existence criante des inégalités scolaires que l’on peut nommer injustices sociales tellement le déterminant majeur reste l’origine sociale. Le plus probant a été la visibilisation des inégalités numériques nécessaires à l’accès à la continuité scolaire. De même, la réforme du lycée, avec le fonctionnement par options qui a mis à mal l’accompagnement pédagogique du collectif-classe, rendait quasi impossible l’assignation, dans le but d’éviter les brassages, d’une salle pour un groupe-classe qui n’existe plus. L’importance des effectifs a également été mis en exergue avec l’impossibilité de tenir les distanciations avec une classe entière de 25 élèves, voire d’une trentaine ou plus dans le second degré.
Cela a mis à mal la démocratisation de l'école ?
Selon la définition que l’on donne à la démocratisation, le bilan n’est pas le même. La formulation commune parle d’égalité des chances pour la réussite scolaire. Or, l’idée de « réussite scolaire » est socialement construite : un bon métier, un métier qui paye bien. Elle fonctionne avec l’idée d’une performance en adéquation avec ce modèle social valorisé. De même, ce n’est pas une question de chance qui renvoie à un hasard réduisant la part de responsabilité politique. Ce qui empêche le plus une démocratisation scolaire, c’est que les enfants soient très tôt assignés à une place et une tâche sociale qui n’est pas forcément leur choix. Ce terme laisse aussi à croire que lorsqu’un élève échoue, c’est de sa responsabilité et qu’implicitement les inégalités sont justifiées. C’est terrible pour des enfants. Je donnerai donc plutôt la définition suivante : la démocratisation, c’est la possibilité laissée à tous les élèves, de manière égalitaire, d’accomplir le parcours scolaire de leur choix.
Or, l’enseignement à distance prôné par le ministère n’a pas tenu compte des conditions des familles inégalement à même d’assurer un suivi pédagogique et a donc accentué les décrochages et les décrochements. Selon la DEPP, 10% des élèves du primaire en éducation prioritaire n’ont pu être suivis pour 6% hors EP et on sait que l’accumulation des retards suite à cette période ne pourra pas être compensée pour tous les élèves. Cela aura sans aucun doute des effets sur l’ensemble de leur trajectoire scolaire. Il faut donc observer les faits : depuis quatre ans, les mesures prises vont dans le sens d’un renforcement d’une sélection, voire d’un tri social. Regardons la réforme du lycée ou Parcoursup par exemple.

Mais cette difficulté de démocratie n'est pas nouvelle ?
On pourrait dire qu’il existe une forme de « péché originel » de l’école de Jules Ferry. Malgré une volonté réelle d’instruire tous les enfants et notamment les plus pauvres, il ne va pas jusqu’au bout et maintient les « lycées ». Ce sont des voies de sélection, du primaire au bac, pour les familles les plus riches. On a traqué les familles « pauvres » qui rechignaient à mettre leurs enfants à l’école, mais on a laissé les riches éviter l’école pour tous. Pourtant, le projet de démocratisation, comme ceux plus tard de Jean Zay (1936), du collège unique (1975) ou de l’éducation prioritaire (1981), reste animé par une double boussole : la volonté de tendre à une unification du système éducatif pour éviter les filières parallèles sélectives et la concentration, notamment des moyens, sur les enfants qui en ont le plus besoin. Mais grosso modo depuis la fin des années 90, cette boussole disparaît au profit de l’impératif d’austérité économique qui dicte de plus en plus le fonctionnement de l’école. Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans cette politique de redistribution des richesses. Au contraire, depuis plusieurs années, nous assistons à une accentuation des mesures d’économies budgétaires. Il n’y a qu’à regarder la baisse du nombre de postes, la précarisation générale du métier ou encore l’état de délabrement de certains établissements tandis que l’argent continue de ruisseler sur les prépas ou les grandes écoles.
Vous parlez de "contre-démocratisation"...
Ce qui semble inédit actuellement, c’est la brutalité des réformes et leur caractère systémique. Les attaques se situent à tous les niveaux, de la maternelle à l’enseignement supérieur, guidées par l’idéologie néolibérale. L’obsession d’une valorisation de la réussite individuelle s’accompagne d’un culte de l’évaluation dans une logique de stress et de classement perpétuel. Ce caractère idéologique est maquillé par un prétendu scientisme, engendrant une sorte de « neurobéatitude » qui tend à faire passer ces idées comme une vérité incontestable. Le caractère inédit réside aussi dans un contexte de cascades d’autorité, d’un contrôle à tous les échelons. Y compris celui des cadres avec, fait rare, une tribune récente d’inspecteurs généraux anonymes dénonçant une mise au pas. À l’échelon des enseignants, on assiste à des poursuites des militants, de celles et ceux qui se mobilisent contre les réformes, mais aussi parfois pour leurs pratiques pédagogiques. De même, l’article 1 de la loi sur « l’école de la confiance » entraîne une auto-censure des enseignants qui n’osent plus donner leur nom ou s’exprimer. Tout cela provoque une pression implicite, une dissuasion et une anticipation des attentes pour se protéger. Mais cette coercition touche également les lycéens dont les mobilisations sont violemment réprimées. On pense en particulier aux évènements de Mantes-la-Jolie en décembre 2018 où des lycéens sont mis en joue avec un policier commentant « voilà une classe qui se tient sage ». Cette image d’une classe maintenue dans le silence par les armes et des représentants de l’ordre est terrible par le caractère humiliant mais aussi car le propos symbolise la disparition de la fonction éducative au profit d’une fonction répressive. Elle témoigne d’une criminalisation des gestes et paroles d’enfants, remettant en cause leur droit et invisibilisant tout traitement éducatif.

L'école comme lieu d'apprentissage n'est pas une évidence ?
Il y a une tendance actuelle, surtout à gauche mais pas seulement, à considérer que l’école doit être d’abord un lieu de bien-être, avec une mise en avant du respect du rythme de chacun, des exercices de pleine conscience, etc. Cela renvoie aux critiques fortes contre l’école traditionnelle considérée comme une antichambre de la caserne et de l’autorité ; critiques auxquelles certains pédagogues ont répondu par la création d’espaces alternatifs, lesquels aujourd’hui coûtent tout de même un demi SMIC par mois, ce qui, on en conviendra, interdit toute présence de familles populaires. En outre, certains de ces établissements, que je détaille dans mon livre, me semblent davantage relever d’une zone de loisirs et de confort que d’une école. L’école doit bien être un lieu de travail où on apprend. Plusieurs pédagogues, tels Célestin Freinet, Ferdinand Buisson ou Paul Robin, ont pensé la question des savoirs et savoir-faire à travailler dans l’école publique dans un objectif d’une école du peuple. La question d’identifier des savoirs potentiellement mobilisables dans la société, avec une égale dignité des disciplines, qu’elles soient manuelles ou intellectuelles, sans conditionnement de jugement de l’une supérieure à une autre. Cela renvoie à une école visant l’émancipation. Je suis convaincue qu’il faut redonner ses titres de noblesse à l’émancipation. Le terme a été confisqué et détourné en une idée d’une libre entreprise de soi, d’un moyen d’échapper à son milieu dans un projet individualiste. Or, on s’émancipe à côté des autres et grâce aux autres. L’émancipation relève d’une visée sociale et collective, portée par une volonté de justice sociale et d’abolition des dominations. C’est finalement plus large qu’une démocratisation, c’est repositionner l’école publique comme un espace de protection des plus démunis, et comme véhiculant des valeurs et des savoirs pour en finir avec les injustices.
C'est replacer l'école comme un service public incontournable ?
Il n’y a pas d’émancipation possible sans un service public d’éducation. L’école commune, comme bien collectif, repose sur la condition première de sa gratuité et donc par une redistribution des richesses. De plus, un service public d’éducation suppose un caractère désintéressé. De ses agents qui n’y entrent pas pour faire carrière individuellement, des élèves que l’on n’y met pas dans un objectif de se concurrencer. Désintéressé également de commandes du marché. Pour être un lieu d’émancipation, l’école doit être à l’abri des endoctrinements, d’où l’importance de son cadre laïque, mais aussi de toutes tentatives d’emprise néo-libérales. Affirmer l’urgence d’un service public d’éducation implique aussi qu’il soit conçu pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il ne s’agit évidemment pas de brader le savoir mais de construire un lieu d’apprentissages où les enfants des milieux populaires ne se sentent pas relégués. C’est une condition de base.
On peut donc encore rêver l'école ?
Oui, il faut justement ! Penser l’école comme une utopie. D’une part car ça fait du bien, que cela projette vers des lendemains potentiellement meilleurs. On ne peut pas capituler. D’autre part, car cela évite d’en faire une institution qui ronronne. Les élèves eux-mêmes d’ailleurs doivent être autorisés à ces remises en question. Vivre l’école comme une institution qui a des promesses, c’est la condition pour imaginer un autre monde possible.