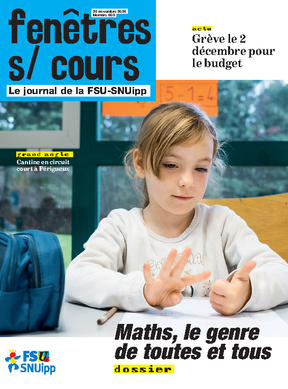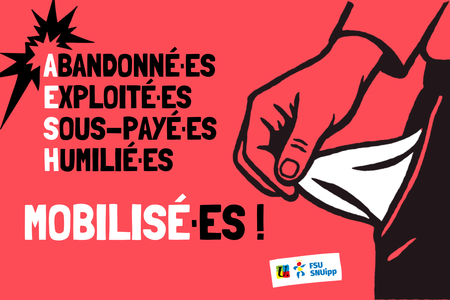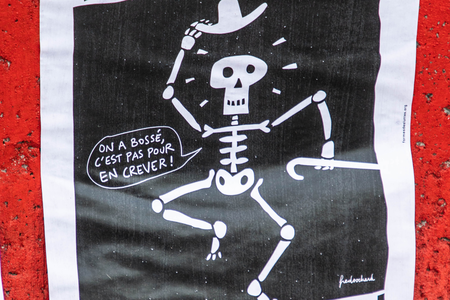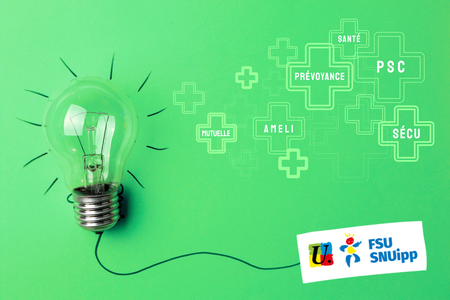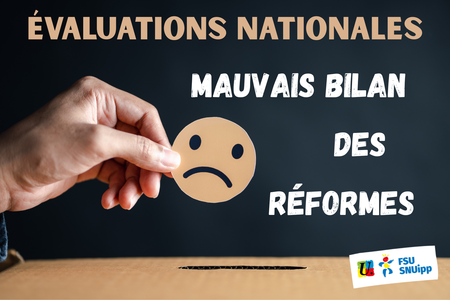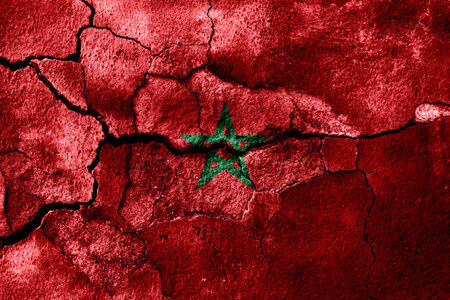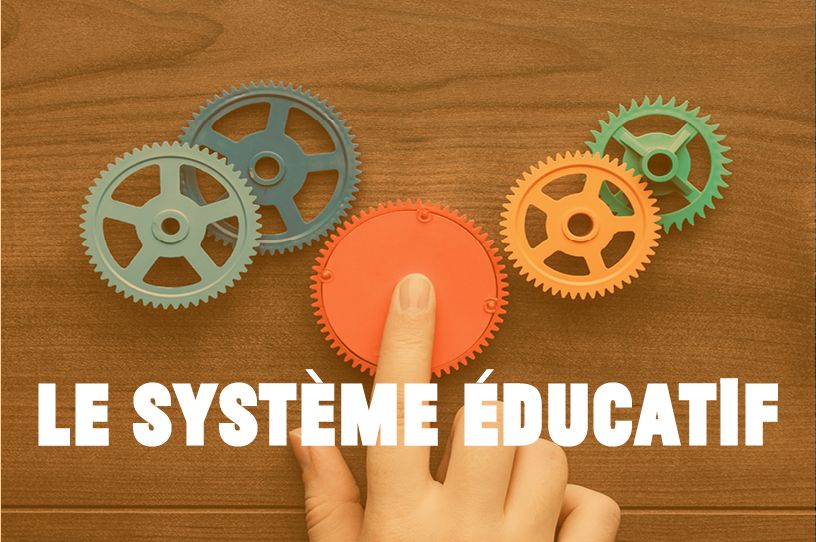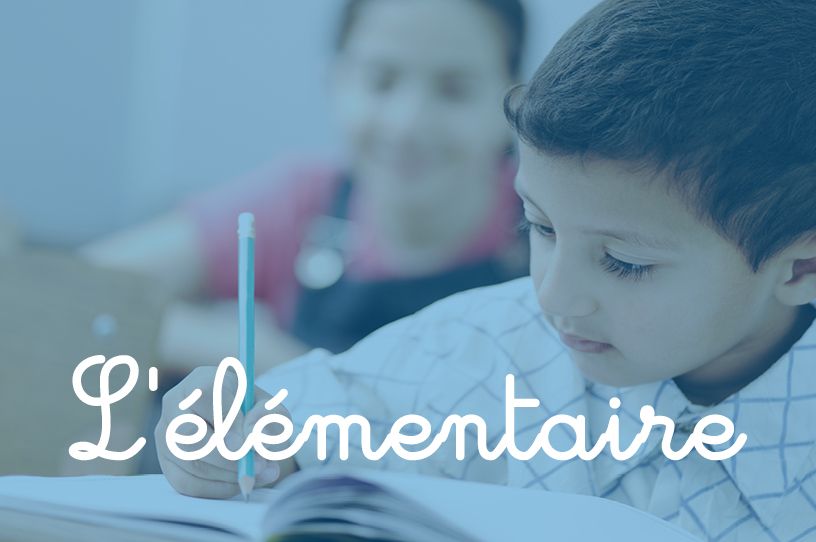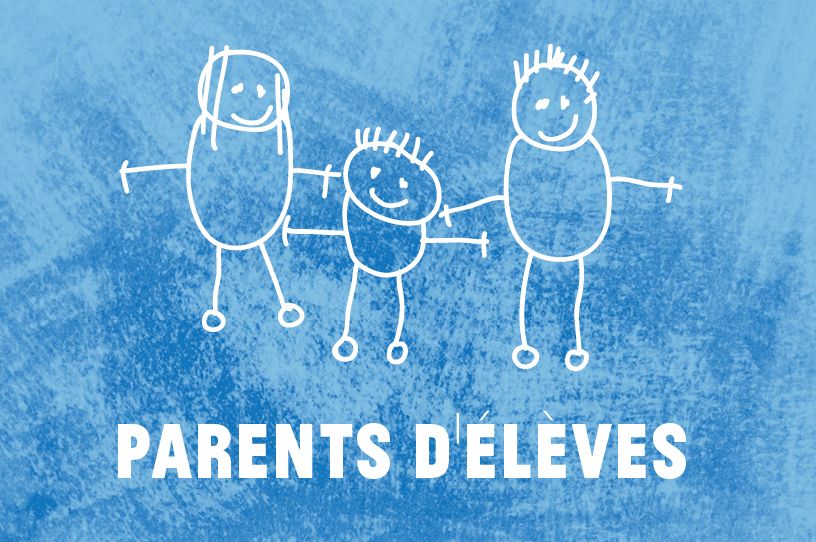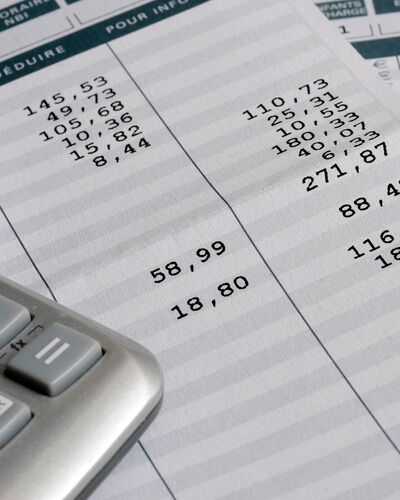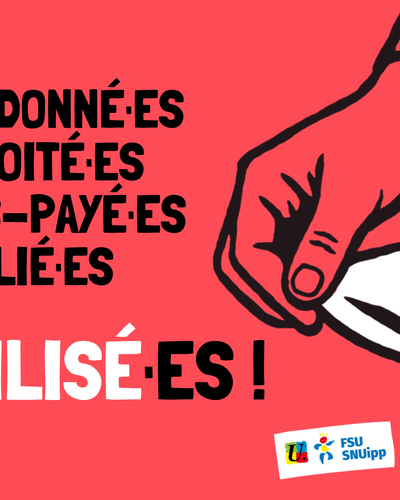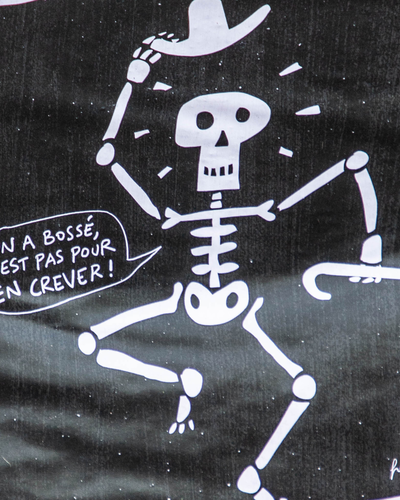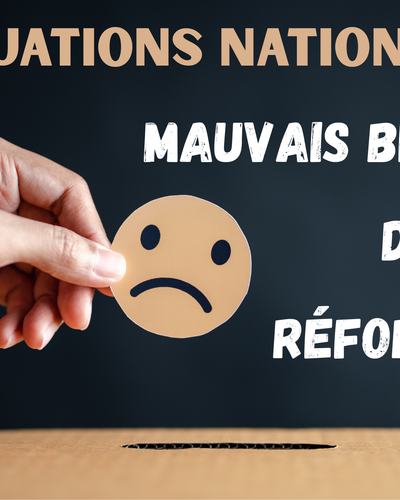"Prendre un peu de hauteur théorique..."
Mis à jour le 18.12.21
min de lecture
Les programmes actuels proposent des entrées thématiques utilement structurées autour de verbe d'action....mais en même temps la formation des enseignants et enseignantes est catastrophique.
Xavier Leroux est professeur des écoles à Tourcoing, docteur en géographie, membre associé au laboratoire «Discontinuités» (Université d’Artois) et membre de l’association les Clionautes. Il mène diverses activités de formation, de production scientifique et de vulgarisation en faveur de la géographie à l’école primaire.

Que pensez-vous de la place de la géographie dans la formation initiale et continue ?
La situation est tout simplement catastrophique. Concernant la formation continue, la focalisation sur les « fondamentaux », que sont censés représenter le français et les mathématiques, est assumée par le Ministère depuis l’année 2018-2019 si bien que la géographie, comme les autres disciplines « secondaires » d’ailleurs, a tout simplement disparu. Au sujet de la formation initiale, nous sommes sur un volume horaire dérisoire, toujours en baisse sur l’ensemble du Master, notamment pour qui ne choisirait pas la discipline comme module.
Quels concepts de base mettre en avant pour la géographie à l'école ?
C’est précisément cette situation désastreuse qui m’amène à raisonner de cette façon. Avec aussi peu de guidage, j’en viens à penser qu’il est indispensable de prendre un peu de hauteur théorique et conceptuelle pour maîtriser la « grammaire » de base de l’espace, l’objet d’étude de la géographie. L’espace est fait de formes et de dynamiques. Les formes principales sont les points comme les gares d’un réseau ferroviaire, les lignes comme les limites d’un quartier et les surfaces avec, par exemple, les zones de chalandise d’une chaîne de magasin. Mais il y a également à travailler sur les concepts de répartition, de localisation, de distance…Concernant les dynamiques spatiales, on peut citer notamment la croissance d’une ville, la diffusion d’un virus, la mobilité domicile-travail ou encore la prospective avec l’évolution d’un espace dans le temps. Dans l’idéal, il faudrait rester vigilant aux évolutions épistémologiques de la discipline afin de savoir interpréter les changements de programme. Mais sans formation, ces quelques concepts me semblent pouvoir survivre aux modes et à l’absence d’accompagnement de nos collègues généralistes non géographes.
En quoi une approche par thèmes peut permettre de faire sens ?
Raisonner autour d’un thème me semble permettre d’éviter l’écueil d’une approche cloisonnant les échelles spatiales. Plutôt que de traiter des transports en France en CE2, en Europe en CM1 et dans le monde en CM2, il est possible d’envisager de prendre ce thème des transports et de lui affecter un certain volume horaire dans une année du cycle pour pouvoir en cerner finement tout le potentiel de lecture de l’espace autour des concepts précités. Les programmes actuels nous proposent justement des entrées thématiques ici utilement structurées autour de verbes d’action, « se déplacer », « mieux habiter », « consommer », etc. mais qui peuvent peut-être sembler parfois trop larges. Il n’est pas interdit d’envisager d’autres thèmes, non expressément cités par le programme, mais qui permettront de « retomber » sur ses attendus notionnels, des thèmes suffisamment vivants pour susciter l’intérêt croisé des élèves et des enseignants. Par exemple, le thème de la santé devenu incontournable avec des thématiques comme la diffusion spatiale d’un virus ou l’accessibilité à une maternité et enfin celui de l’éducation par les déterminants de l’affectation dans une structure scolaire ou la chronologie spatiale du parcours éducatif. Et pourquoi pas d’autres entrées culturelles, notamment le sport, la musique, la gastronomie ?
Cela permet-il de traiter tout le programme ?
Pour moi, l’essentiel tient là-dedans mais il faut bien entendu laisser un peu de place pour d’autres éléments de structuration de la discipline : l’étude des grands repères spatiaux, si possible de manière ritualisée pour ne pas en faire une sorte de préalable sans lequel il ne serait pas permis d’accéder à l’analyse des formes et des dynamiques de l’espace ; quelques séances sur l’outillage méthodologique au travers de la catégorisation et la lecture des grands types de documents, cartes et photographies principalement mais aussi graphiques, tableaux, textes et autres schémas ; se laisser enfin la latitude d’exploiter toute sortie sur le terrain, récurrente ou occasionnelle, subie ou provoquée, afin d’aborder notamment le concept de prospective, réelle nouveauté des programmes de 2015 chapeautant l’ensemble du cycle 3.