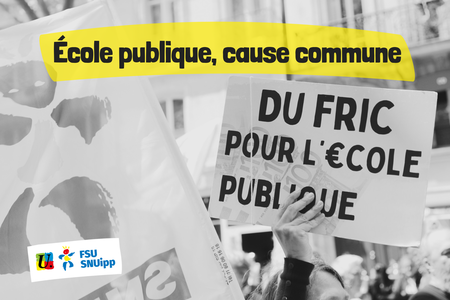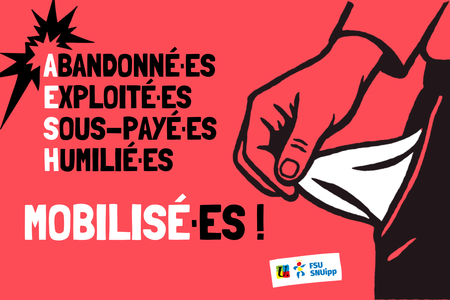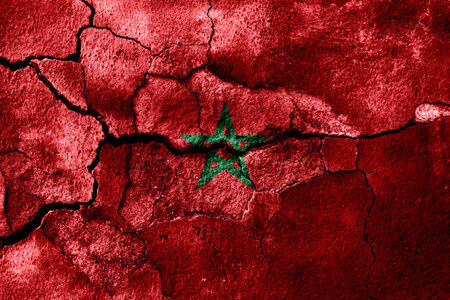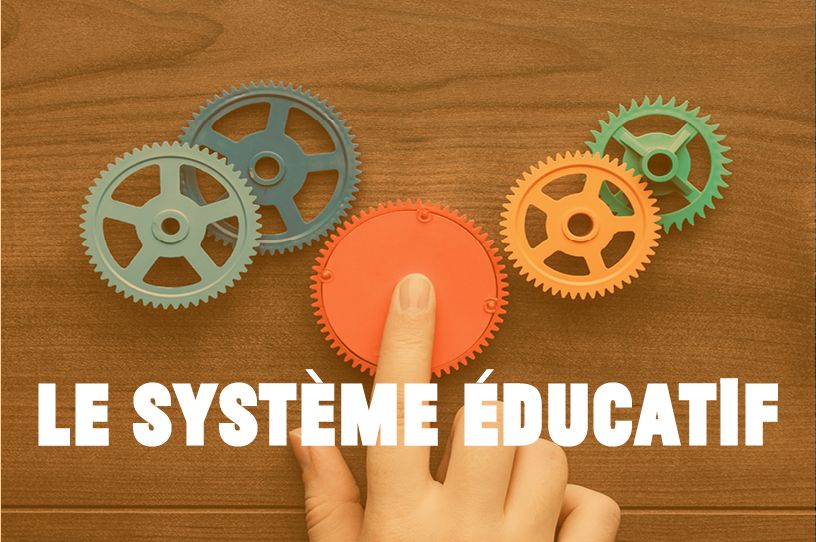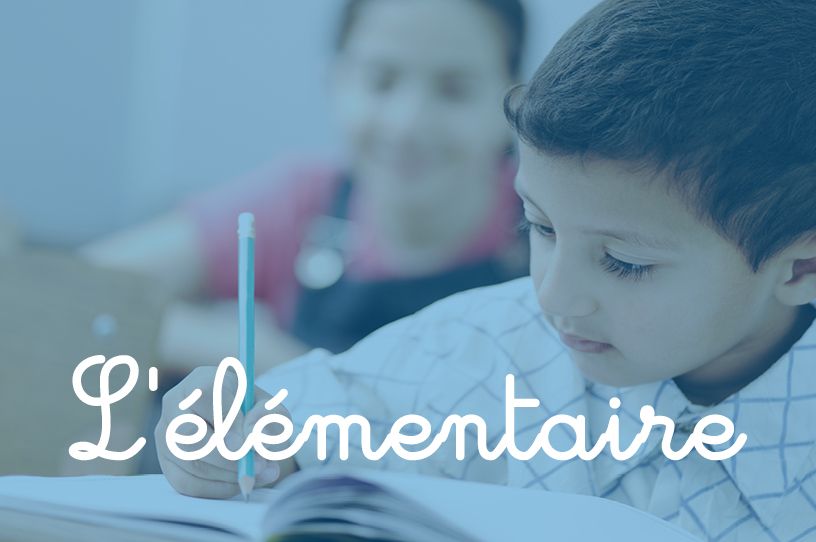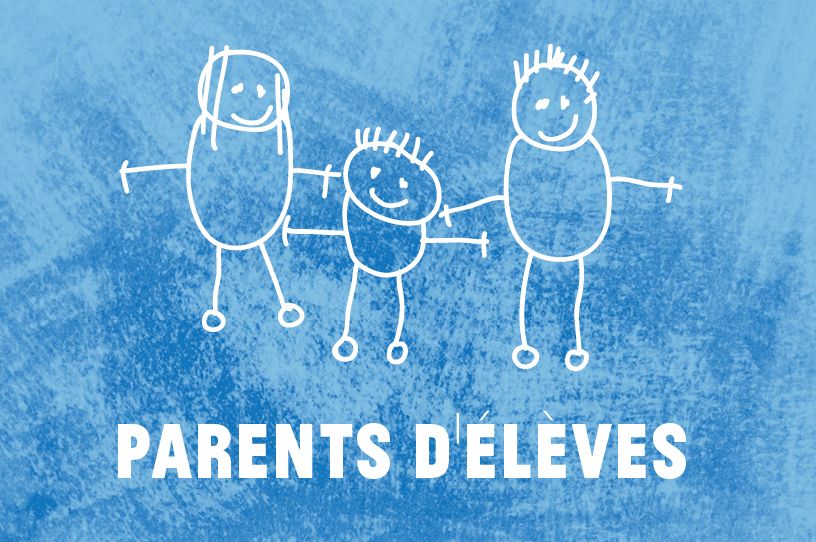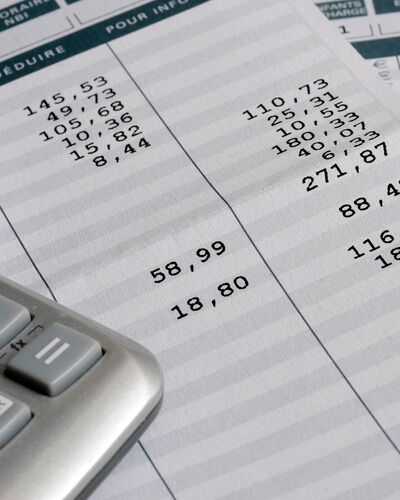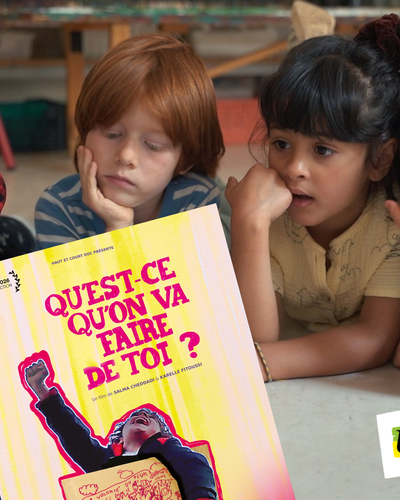“Permettre une prise de parole plus équitable”
Mis à jour le 19.11.25
min de lecture
Les élèves issus de milieux sociaux favorisés prennent plus souvent la parole en classe que les élèves des milieux populaires et sont aussi plus souvent sollicités par les PE. Pour Sébastien Goudeau, qui s’intéresse aux pratiques langagières dès l’école maternelle, ces différences s’expliquent notamment par une socialisation familiale qui favorise leur expression de soi, ce qui n’est pas le cas pour les autres. Prendre conscience de ces mécanismes et les comprendre sont nécessaires à des changements de pratiques en classe pour une répartition de la parole plus égalitaire
Sébastien Goudeau est professeur des universités en psychologie sociale à l’Université de Poitiers, responsable de l’Inspe de Niort et ancien PE. Ses travaux portent sur l’influence des contextes sur l’apprentissage et la construction des inégalités scolaires. Il a publié en 2025 avec Céline Darnon Les inégalités scolaires : Comprendre et agir, Ed De Boeck Supérieur et a co-mené l'étude « Les enseignants de maternelle offrent moins d’opportunités de participation aux élèves issus de milieux populaires qu’à ceux issus de milieux plus favorisés » publiée sur PNAS.
 ©Hidalgo/Naja
©Hidalgo/Naja
QUELLES DIFFÉRENCES OBSERVÉES DANS LES PRATIQUES LANGAGIÈRES EN MATERNELLE ?
Lorsque nous sommes allés filmer des moments de regroupement en classe de grande section, nous avons observé des différences liées à l’origine sociale dans les prises de parole. Les élèves issus de milieux favorisés coupent plus souvent la parole à l’enseignant ou aux autres camarades pendant les discussions. Ils répondent plus souvent aux questions collectives, adressées à la classe entière et leur prise de parole est plus longue que celle des enfants de milieux populaires.
Les enseignants, eux, ont tendance à distribuer plus fréquemment la parole aux élèves de milieux favorisés. Et quand les élèves coupent la parole, les PE laissent davantage faire les élèves de milieux favorisés et recadrent davantage les enfants de milieux populaires et ce, indépendamment de leur niveau de langage.
D’OÙ VIENNENT CES DIFFÉRENCES ?
Les enfants sont socialisés différemment à la maison. Dans les milieux favorisés, les familles ont les ressources financières, temporelles et sociales permettant aux enfants de faire des choix dans leurs habits ou les activités extra scolaires et ils sont régulièrement invités à exprimer leur opinion, leurs envies. Cela amène une socialisation à l’expression de soi, les enfants sont entraînés à oraliser ce qu’ils ressentent, ils intègrent l’idée que ce qu’ils pensent et ont à dire est intéressant et mérite d’être entendu.
Dans les milieux populaires, les familles vivent dans un monde beaucoup plus contraint, dans lequel il y a moins de possibilités de contrôle, moins de ressources. Cela amène les parents à davantage apprendre aux enfants que « dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut », mais qu’on essaie de faire attention aux autres, à l’environnement, sans se mettre en avant et « faire son intéressant ».
À cela s’ajoutent les différences liées aux expériences culturelles des enfants. Des élèves qui connaissent déjà l’album lu en classe peuvent intervenir avec beaucoup plus d’aisance que ceux qui le découvrent pour la première fois. Les enfants qui reviennent d’un voyage à Paris ou à l’étranger vont également avoir des choses à partager qui vont susciter l’intérêt et l’attention très facilement.
“Dans les milieux favorisés, (...) les enfants sont entraînés à oraliser ce qu’ils ressentent, ils intègrent l’idée que ce qu’ils pensent et ont à dire est intéressant et mérite d’être entendu”
LES ÉLÈVES PERÇOIVENT-ILS CES DIFFÉRENCES ET COMMENT RÉAGISSENT-ILS ?
Dès la grande section, quand on présente à des enfants des scénarios fictifs dans lesquels un enseignant interroge davantage un autre élève ou dans lesquels des élèves parlent plus que d’autres, les enfants expliquent ces différences par des caractéristiques internes aux élèves. Pour eux, les élèves parleurs sont des élèves sages, qui connaissent beaucoup de choses alors que le fait de peu contribuer à la discussion de classe est interprété comme un manque d’intelligence ou d’effort. Ils mobilisent très peu des facteurs externes comme le fait que les parents lisent beaucoup d’histoires à la maison. Une analyse qui peut conduire à une mauvaise image scolaire de soi qui va, à son tour, renforcer la tendance à moins participer. Dans l’autre sens, un élève souvent interrogé, se perçoit et est per-çu par les autres comme un élève intelligent, attentif, engagé. Cela renforce le sentiment d’efficacité personnelle.
LES PE SONT-ILS INFLUENCÉS PAR LES STÉRÉOTYPES SOCIAUX ?
Il y a un paradoxe intéressant : les PE ont conscience du déterminisme social, de l’influence de ce qui se passe à la maison sur ce qui se passe en classe et sont motivés pour réduire ces inégalités. Mais, ils n’ont pas nécessairement conscience qu’ils peuvent eux-mêmes distribuer la parole de façon inégale selon des stéréotypes sociaux. Cela s’explique notamment par le fait que faire classe est une activité qui sollicite énormément les ressources cognitives.
Quand il faut gérer un groupe, apporter les régulations nécessaires, être interrompu, tout en ayant une séance ou une progression en tête, c’est très dur d’être en même temps attentif à qui a parlé et combien de temps. D’où l’intérêt de faire ces études, de pouvoir documenter, d’outiller pour nourrir la réflexion. Former les enseignants à la compréhension de ces phénomènes et à avoir des pratiques de gestion de groupe différentes est très important
“Un élève souvent interrogé, se perçoit et est perçu par les autres comme un élève intelligent, attentif, engagé”
COMMENT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES ?
Certaines pratiques de classe peuvent permettre une prise de parole plus équitable. Le fait d'avoir par exemple régulièrement un carnet où on peut cocher en fin de journée les élèves qui ont parlé. Cela permet de conscientiser les prises de parole et d’agir. Les « feed back » des enseignants sont aussi un levier puissant. La manière dont ils réagissent à la difficulté ou à la réussite va colorer la manière dont les élèves vont interpréter les différences entre eux.
Les enseignants font aussi parfois appel aux expériences vécues par les enfants en dehors de l’école, pendant les vacances, pour les aider à s’exprimer. Mais s’appuyer sur ces expériences familiales, où les inégalités sociales sont les plus fortes, renforce les inégalités scolaires. Et si les PE peuvent agir dans leurs classes, la réduction des inégalités de développement du langage passe avant tout par la réduction des inégalités de conditions de vie des familles.