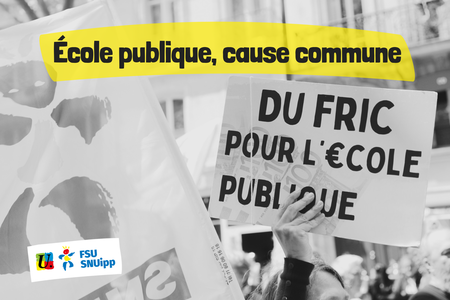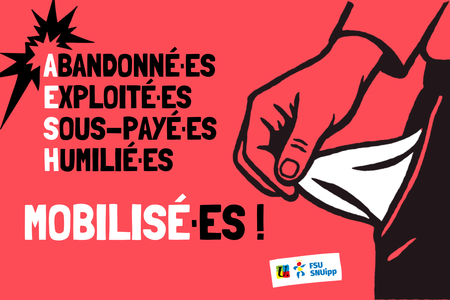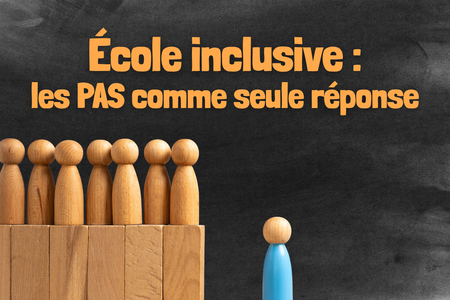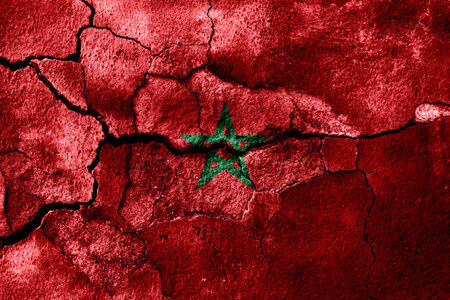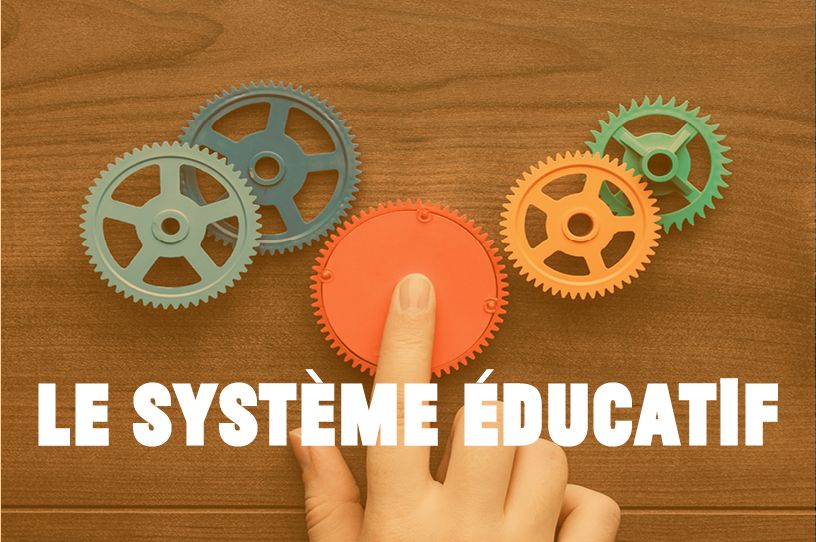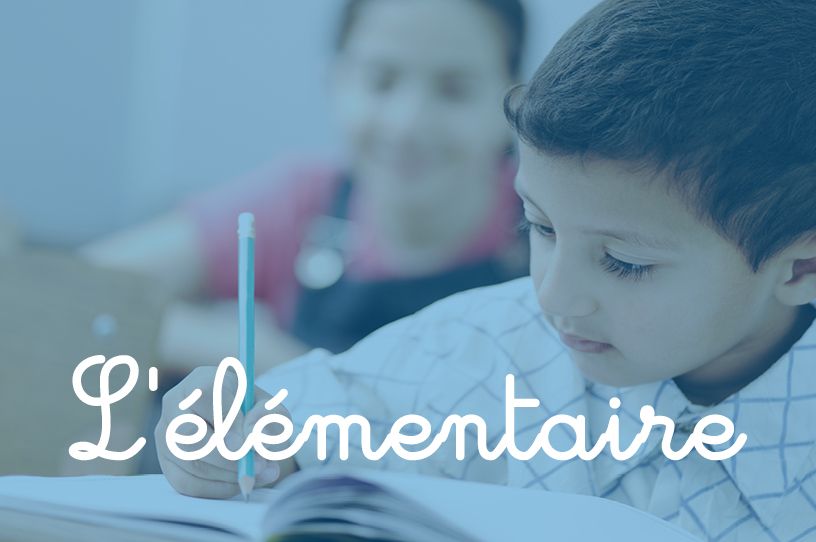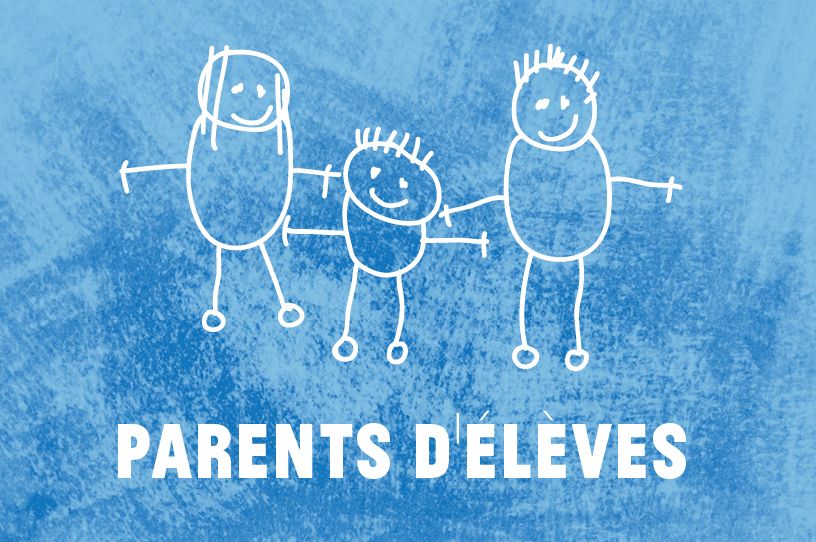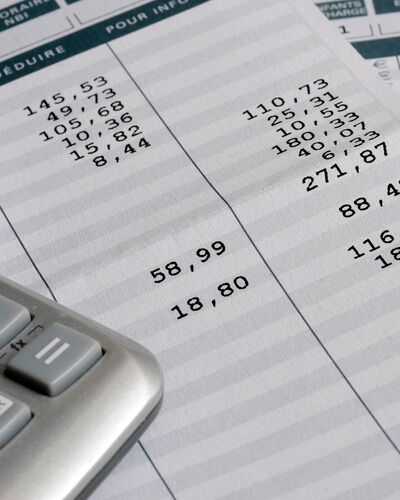"Penser l'accompagnement"
Mis à jour le 18.12.21
min de lecture
Dynamiques locales et synergies école/université participent d'un nouvel élan porté par les professeur.es d'école dont celui de faire classe en pleine nature.
Alix Cosquer est chercheuse en psychologie environnementale au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) à Montpellier. En 2021, elle a publié Le lien naturel, pour une reconnexion au vivant aux éditions Le Pommier et La sylvothérapie dans la collection « Que sais-je ? » aux PUF.

Comment caractériser la déconnexion à la nature, en particulier pour es enfants ?
La déconnexion à la nature prend la forme d’un éloignement à la fois physique et psychique d’avec le vivant. L’éloignement physique est généré par nos modes de vie contemporains, aux environnements artificialisés. On passe plus de temps à l’intérieur, avec des contacts restreints avec une nature de moins en moins complexe et variée. Cette dimension physique est en interrelation avec la psychologie. Quand on se trouve moins confronté à la nature, l’importance qu’on lui accorde diminue dans le champ des représentations et des valeurs. Coupés de la nature, les enfants s’y intéressent moins. Dans un contexte de recul de la biodiversité et de progression de modes de vie en intérieur ou en immersion avec le virtuel, les jeunes générations sont encore plus exposées à des relations appauvries avec le vivant non humain.
Comment l'école peut-elle participer à la reconnexion à la nature ?
Le cadre institutionnel de l’école est intéressant car il permet de dépasser des dynamiques limitées à la sphère individuelle. La mise en contact physique concrète avec des éléments de nature, voire l’immersion dans des espaces naturels est indispensable. Il faut également penser l’accompagnement. Il ne suffit pas de mettre les enfants en situation dans une forêt pour qu’il se passe forcément quelque chose. Des dispositifs comme les « aires éducatives », marines ou terrestres, permettent de mettre les élèves en relation avec un espace de proximité dont ils ont la charge au cours d’une année. Les élèves y sont engagés dans des projets de découverte mais aussi de protection du vivant. L’enchainement réitéré d’observations inscrites dans la durée produit bien plus d’effets qu’une occasion unique. En quartier urbain populaire, on peut aussi travailler à la végétalisation des cours d’école. Sachant que ce qui compte au final n’est pas tant de renforcer la biodiversité dans l’espace scolaire mais bien d’augmenter les interactions entre enfants et nature.
Pour ce faire, quels obstacles doivent surmonter les PE ?
Les obstacles sont multiples mais surmontables. Ils peuvent être budgétaires quand les espaces ne sont pas proches de l’école et nécessitent un transport, à négocier avec les collectivités territoriales. Les parents peuvent formuler des craintes concernant la sécurité. Mais on peut y travailler de manière collaborative pour les lever progressivement. Les connaissances concernant les bénéfices en termes de développement et d’apprentissages sont parfois peu diffusées. Malgré de fortes envies, des enseignants peuvent ne pas se sentir capables de mener leur classe en extérieur parce cela implique un décalage avec les pratiques usuelles. C’est donc une question de formations, qui se développent dans de nombreux territoires. Les représentations des enfants peuvent également constituer un obstacle. Dans une recherche menée sur des projets de transformation des cours d’école, les réponses des élèves montrent des différences d’expression sur le bien-être à l’école en faveur d’une école végétalisée par rapport à une autre, très artificialisée. Mais sans que la question de la présence de nature ne soit explicite chez les enfants. Quand on leur demande ce qui leur fait du bien, ils n’identifient pas la nature comme une source de bien-être, davantage associé à des dispositifs ludiques et sportifs ou des pratiques sociales et de consommation. Ce décalage peut constituer un obstacle à prendre en compte, à travailler avec les enfants.
Quels bénéfices pour les élèves et les PE ?
Sur le terrain pédagogique, les relations au vivant participent de la restauration d’une attention psychique et d’une baisse du niveau de stress qui permettent de mieux se concentrer et donc de mieux apprendre. Les pratiques physiques produisent des effets bénéfiques sur la santé, en diminuant les risques liés à la sédentarité. Des bénéfices sociaux émergent avec davantage de collaboration entre enfants. La multiplication d’expériences avec le vivant peut être mutuellement bénéfique pour humains et vivant non humain. Elle génère des attitudes et des comportements favorables à l’environnement qui perdurent à l’âge adulte. Les pratiques et postures enseignantes évoluent également vers des approches moins directives qui « laissent venir » les questionnements de l’enfant. Ces transformations soulèvent des questions générales de métier : comment faire participer et impliquer l’élève, le faire devenir acteur de ses apprentissages ?