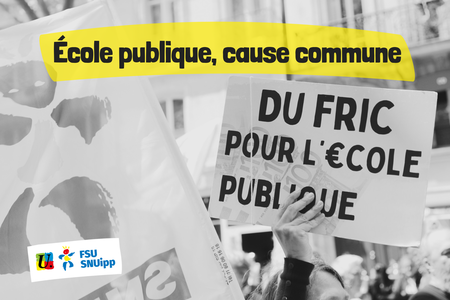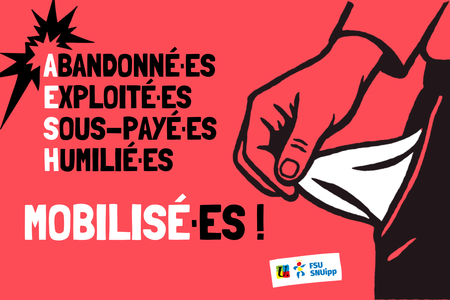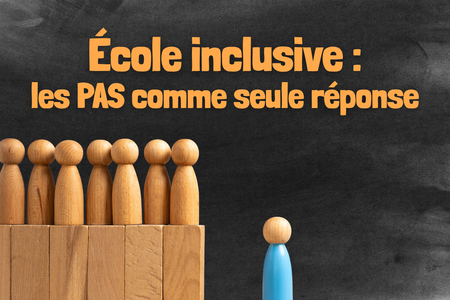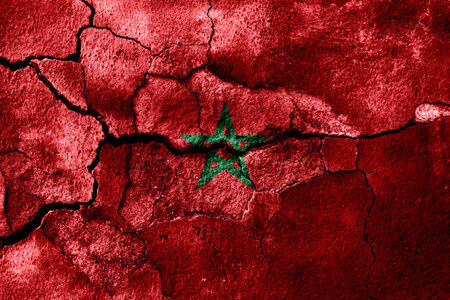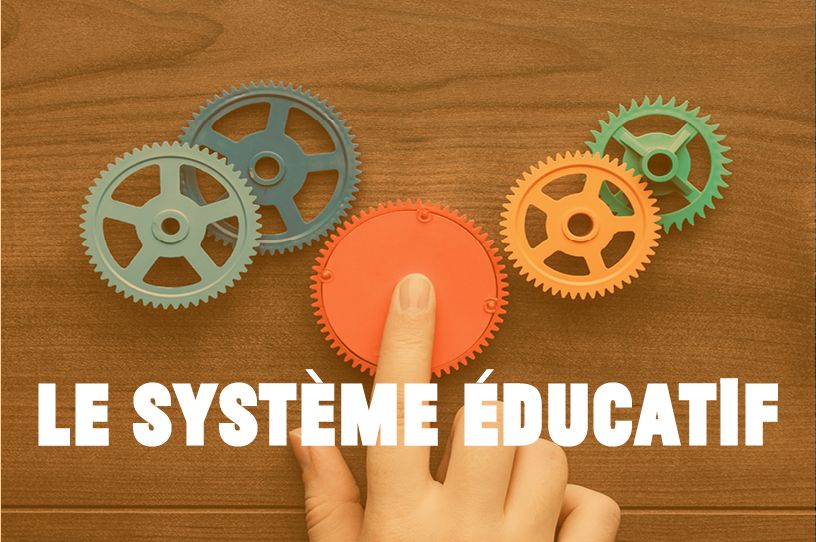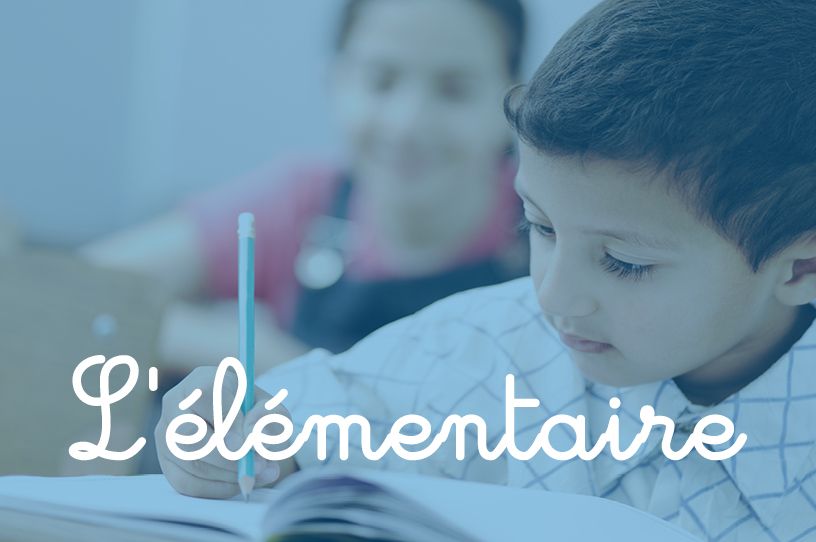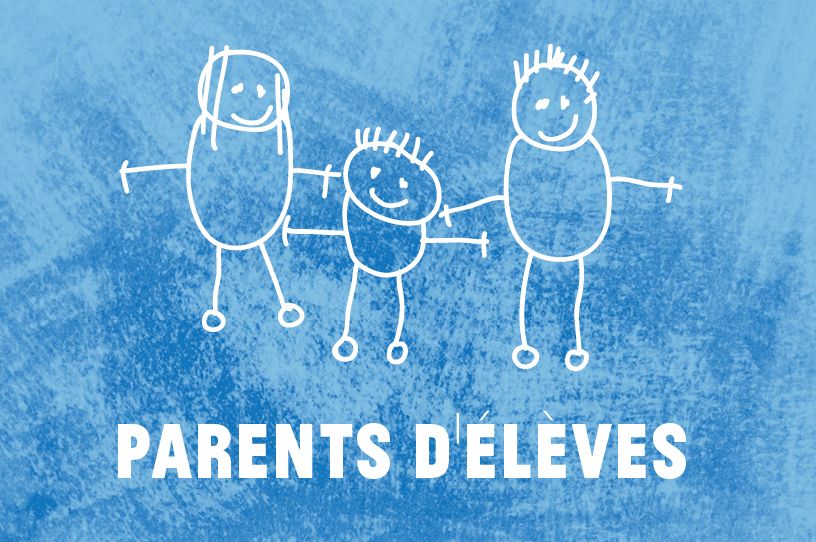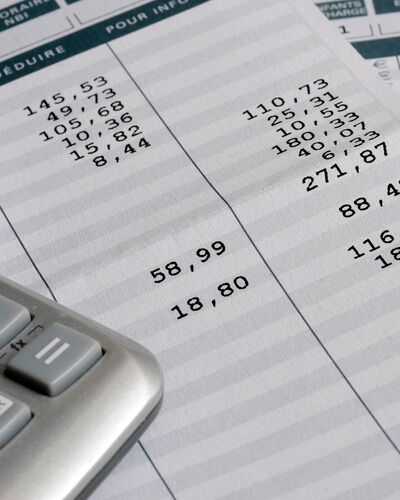“Les nouveaux programmes réduisent la compréhension à son niveau premier”
Mis à jour le 19.11.25
min de lecture
Maîtriser la langue écrite suppose de se confronter, en lecture comme en écriture à la complexité d’écrits composées d’éléments hétérogènes (textes, figures, photos, schémas...). La compréhension des textes littéraires dépasse quant à elle le seul niveau de l’identification des personnages et de la suite d’actions. Elle intègre également l’interprétation et l'appréciation de valeurs qui sous-tendent le récit et engagent la lectrice ou le lecteur comme sujet. La littératie qui regroupe l’ensemble de ces compétences reste en marge des nouveaux programmes. Elle est pourtant essentielle pour former dès la maternelle les élèves à une future citoyenneté pleinement responsable.
Catherine Huchet est enseignante-chercheuse à l’Université de Nantes, rattachée au laboratoire “Centre de Recherche en Education de Nantes” et formatrice en didactique du français à l’Inspé de l’académie de Nantes. Ses travaux explorent la didactique de la littérature en lien avec l’éducation à la citoyenneté ou l’instruction des questions socialement vives.

QU’EST-CE QUE LA LITTÉRATIE ?
La littératie recouvre les compétences qu’implique lire ou écrire un texte. Elles sont à la fois « techniques » - décodage, encodage, graphisme - et multidimensionnelles – maîtrise de l’orthographe, de la syntaxe, de la cohérence textuelle, de la prise en compte de l’interlocuteur. Dans une société « littératiée », nous sommes quotidiennement exposés à des documents composites, en réception comme en production. Ceux-ci regroupent à la fois textes, schémas, photos, légendes…
Apprendre à relier ensemble ces différents espaces de signes peut exclure des élèves qui ne sont pas accompagnés par des parents qui ont l’habitude de les fréquenter. Même les manuels scolaires sont un assemblage d’éléments hétéro-gènes et non adjacents où construire un sens de lecture est complexe. Cette compétence est peu prise en charge par l’école, comme si la fréquentation régulière de ces écrits suffisait à sa maîtrise.
QU’EST-CE QUE COMPRENDRE ?
Comprendre consiste à se créer une représentation du texte lu, s’en faire le film en répondant aux questions « qui sont les personnages ? quels sont leurs problèmes ? comment s’associent ils pour les résoudre ? ». Mais la didactique de la lecture appréhende la compréhension comme l’un des processus pour construire le sens d’un texte, à l’égal de l’interprétation et de l'appréciation... La compréhension prend alors une dimension symbolique. Le récit n’est pas seulement une histoire mais porte des valeurs - justice, respect de l’autre… - qui impliquent le lecteur comme sujet. Ces valeurs orchestrées par la narration ne sont pas forcément cohérentes avec celles du jeune lecteur qui a tendance à rechercher ce qui le conforte.
Or, même si plusieurs pistes interprétatives sont possibles, le texte révèle un faisceau d’indices qui rendent certaines hypothèses plus robustes que d’autres. Une lecture débattue avec ses pairs est plus à même d’accepter des valeurs du texte divergentes. Avant de choisir de les intégrer ou de les reconnaître comme différentes des siennes. La seule représentation mentale du texte ne suffit donc pas. Le rapport aux valeurs est essentiel pour apprendre à comprendre mais reste un impensé des programmes.
“Le rapport aux valeurs est essentiel pour apprendre à comprendre”
QUELLE MAÎTRISE PAR LES ÉLÈVES EN FRANCE ?
Nos élèves s’en sortent à peu près avec les compétences de compréhension les plus simples : en début de texte, prélever les principales informations, identifier les personnages... Plus on avance dans le texte, plus les élèves ont du mal à s’en faire une représentation cohérente. Ils sont démunis face aux processus interprétatifs plus fins : saisir la motivation des personnages, les valeurs au nom desquelles ils agissent, comment la narration se positionne par rapport à ces valeurs...
Souvent les élèves ne répondent pas, ce qui interroge aussi sur la pertinence du questionnaire de lecture. L’enquête « Lire, écrire au CP » dirigé par Roland Goigoux montrait qu’il n’y avait quasiment pas d’enseignement de la compréhension et de l’interprétation. Dix ans après, rien n’a vraiment changé. En insistant sur décodage et fluence avec une césure entre littérature et écriture, les nouveaux programmes réduisent la compréhension à son niveau premier. Le tout, sans aucun moyen réel consacré à la formation pour inverser la tendance.
COMMENT LEVER LES OBSTACLES À LA COMPRÉHENSION ?
Les principaux obstacles consistent à accéder à l’implicite : dans un texte narratif, les valeurs et motivations sous-tendant les actions des personnages et leur enchaînement. Faire des inférences interprétatives suppose élargissement lexical et enrichissement culturel. Lire un texte documentaire nécessite par ailleurs de comprendre des éléments de sens hétérogènes - un schéma ne se lit pas comme un texte – et maîtriser des savoirs– un document historique ne se lit pas comme un document scientifique. Entrer dans la complexité dès la maternelle à travers la lecture magistrale à haute voix est donc un impératif. C’est le texte choisi qui doit guider les compétences à travailler et non l’inverse. Bien sûr, la complexité suppose outillage et accompagnement, sans quoi la lecture collective ne ferait que renforcer les inégalités.
“C’est le texte choisi qui doit guider les compétences à travailler et non l’inverse”
LIRE, EST-CE MIEUX COMPRENDRE LE MONDE ?
Un roman est une sorte de laboratoire organisé pour que le lectorat endosse rôles et valeurs des personnages, sans prise de risque. Eprouver de nouveaux sentiments ou émotions permet une meilleure compréhension de soi et de l’autre. Lire permet de comprendre le monde, à condition d’une médiation. C’est moins le livre seul qui nourrit que les discussions autour de la lecture. Les albums de littérature sont donc un moyen de contextualiser les problèmes écologiques, avec des apports scientifiques parallèles, sans instrumentaliser la littérature ou la science au service de l’autre. Littérature et sciences amènent à appréhender de concert la complexité des questions socialement vives, problèmes pernicieux et polysémiques, sans solution immédiate.
“Lire permet de comprendre le monde, à condition d’une médiation”
LIT-ON POUR APPRENDRE, PRENDRE CONSCIENCE OU AGIR ?
On lit pour tout ça, sans hiérarchie. On lit aussi pour comprendre soi et les autres, pour se divertir. Mais la question de l’agir est actuellement prégnante. L’école n’a certes pas la mis-sion de former des militants mais elle confronte les élèves à un paradoxe : elle les expose aux urgences – climatique ou migratoire, par exemple - mais situe l’action pour les résoudre hors de la sphère de l’école. Comme si comprendre l’enjeu du problème ou agir sans prise de risque suffisait à former des citoyens critiques. Agir reste donc un impensé en primaire alors même que, sans connaître en détail le fonctionnement d’une démocratie, des élèves de CP/CE1 savent qu’il y a des adultes en responsabilité qu’on peut sol-liciter pour résoudre les problèmes.
COMMENT S’Y PRENDRE EN CLASSE ?
Travailler à plusieurs car analyser un album prend du temps. Par période, consacrer une semaine ou deux à un album, à raison d’une heure par jour. Les élèves ne se lassent pas si les activités d’écrits appropriatifs, les débats participatifs, la réalisation d’affiches, les séances de lecture à haute voix sont adossés à un projet. Tous les domaines du français sont mis en œuvre donc il n’y a pas de perte de temps. Il faut s’autoriser à toucher à la forme scolaire en instillant du jeu dans la grammaire, l’orthographe, la production d’écrits et la lecture, mis en synergie. Dans un cadre interdisciplinaire – français et sciences ou éducation civique et morale ou artistique…, chacune des séances apporte des éléments de réponse à une question pré-philosophique qui engage les valeurs du sujet lecteur. Par exemple, « que signifie aider une personne en situation de handicap ? ». A la fin du parcours de littérature, organiser un moment de méta-cognition pour faire le point sur qui a été appris des problématiques scientifiques, des sentiments des personnages ou compris d’un moment clé du récit. Mener des lectures en réseau permet enfin de comprendre comment des personnages différents trouvent d’autres réponses à la question traitée.