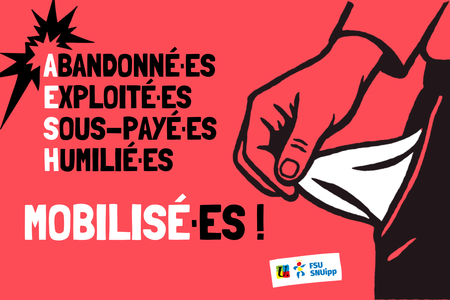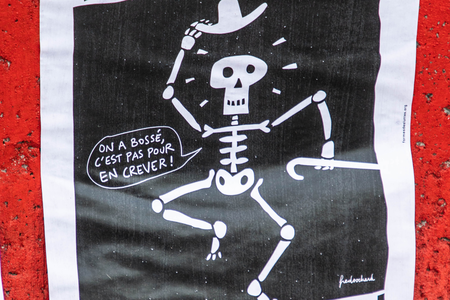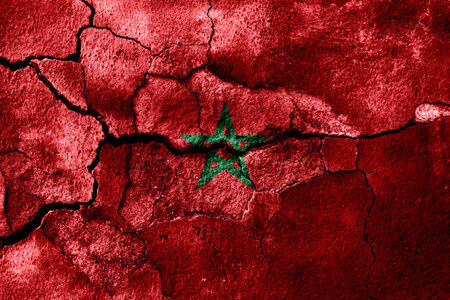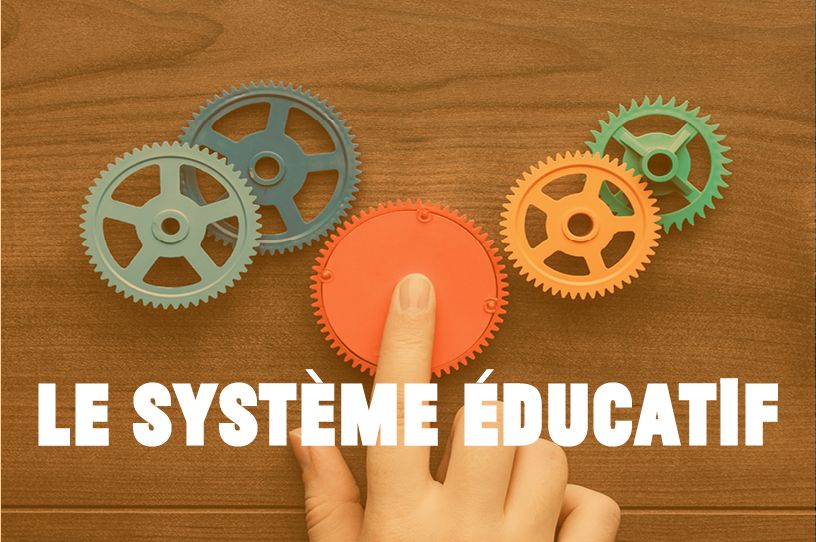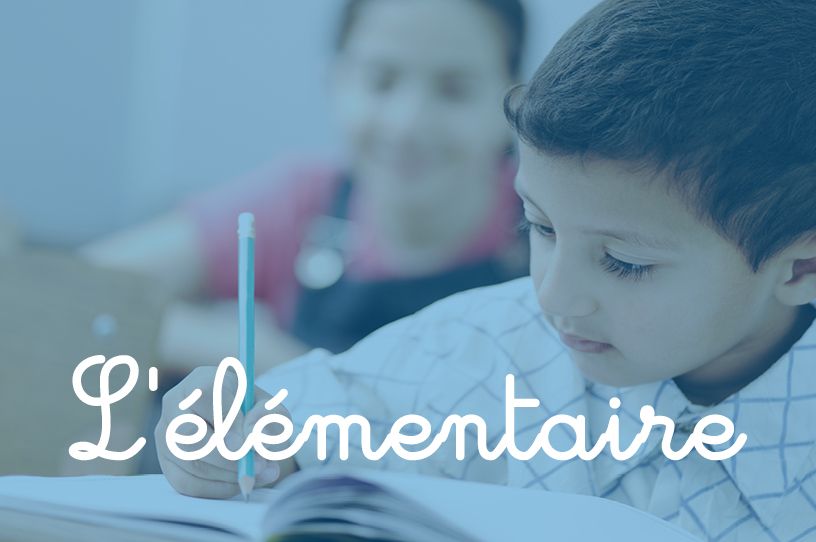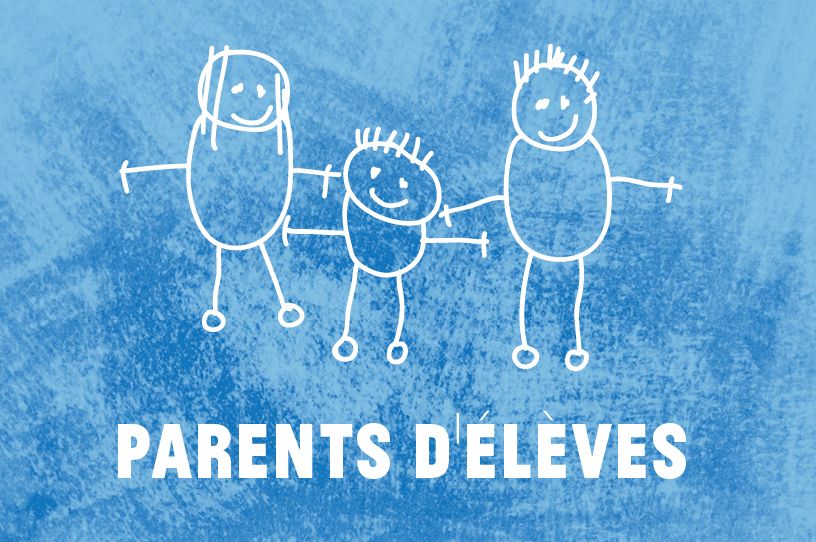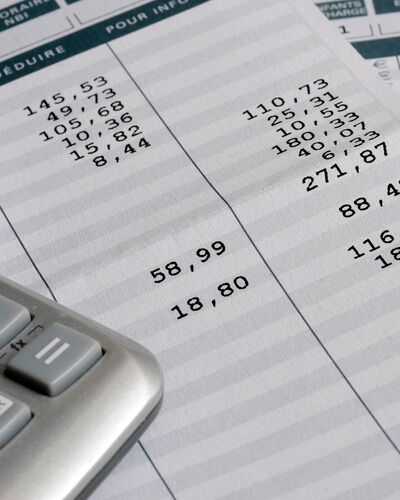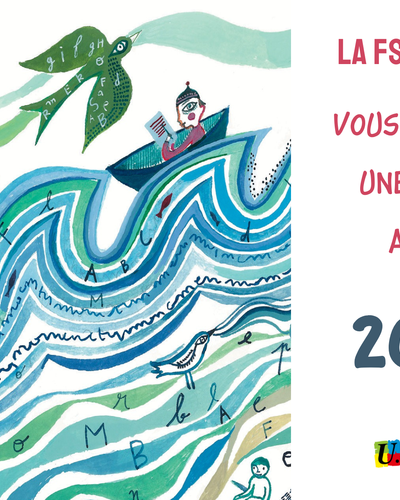“Le changement climatique est dans l’école”
Mis à jour le 25.11.25
min de lecture
Le changement climatique est-il une menace pour l'école ? Les élèves sont-ils vulnérables ? Et les personnels ? Comment adapter le bâti scolaire ? Quel est l'impact des éco-gestes ? Sur quoi agir en priorité ? Autant de questions auxquelles répond la chercheuse dans cette interview.
Magali Reghezza -Zitt est docteur en géographie et aménagement du territoire. Spécialiste de la gestion des risques ainsi que de l’adaptation au changement climatique, elle a été membre du Haut conseil pour le climat.
 ©DR
©DR
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST-T-IL UNE MENACE POUR L’ÉCOLE ?
Le changement climatique se traduit par une intensification des phénomènes extrêmes : vagues de chaleur, incendies, orages violents et sécheresse menaçant les accès à l’eau potable et à l’énergie… L’éducation s’en trouve forcément perturbée. Les bâtiments scolaires ne sont pas adaptés, notamment aux très fortes chaleurs estivales, de plus en plus élevées et durables. Les activités de plein air seront plus difficiles à organiser. L‘accès à l’école sera lui-même entravé, lorsqu’on dépassera les 50 degrés en ville vers 2040/2050. Il l’est déjà au bord de la Méditerranée à cause des orages. En Outre-mer, les cyclones s’intensifient et provoquent une destruction du bâti scolaire. Les familles sont égale-ment touchées et dans l’incapacité de s’occuper de la scolarité des enfants. Les perturbations ou coupures des transports par la canicule, les inondations et/ou les vents violents empêchent les personnels éducatifs et municipaux de travailler. Dans le sud, la multiplication des nuits tropicales, au-dessus de 20°, perturbe la qualité du sommeil des enfants et donc leurs capacités d’apprentissage.
DES ENFANTS SONT-ILS PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES ?
Les petits à la sieste dans un dortoir surchauffé risquent la déshydratation. Les activités en extérieur exposent aux risques de coups de soleil, d’insolation et de cancers de la peau. La dégradation du sommeil par la chaleur nuit à l’attention et à la concentration, notamment pour les enfants qui vivent dans des logements dégradés, des conditions de violence intrafamiliale, de précarité énergétique ou sanitaire, d’exclusion sociale. Dans les pays chauds, les régressions d’accès à l’école pèsent particulièrement sur les filles et les plus pauvres. Les ruptures de scolarisation privent non seulement d’enseignement mais des activités éducatives au cours desquelles l’enfant échange, s’exprime. Et la récurrence des catastrophes porte atteinte à la santé mentale. Quand en milieu rural les calamités agricoles touchent la famille, quand la canicule entraine l’hospitalisation d’un grand-parent, le chômage technique d’un parent, l’environnement anxiogène est fortement ressenti par les plus jeunes et renforcé par la rupture des routines scolaires. Les élèves en situation de handicap sont encore plus vulnérables, notamment ceux qui souffrent de troubles de l’attention, d’hyperactivité ou du spectre autistique. Les vagues de chaleur ou les catastrophes climatiques les déstabilisent car ils rompent des routines. La déscolarisation peut altérer leur santé mentale jusqu’à aboutir à des hospitalisations.
“Nous avons à penser des solutions d’avenir dans un climat actuel qui n’existera plus”
ET DU CÔTÉ DES PERSONNELS ?
Face à l’éco-anxiété des en-fants, les personnels éducatifs sont dé-munis car eux-mêmes victimes du chan-gement climatique. En cas de catastrophe, la perte de repères due à un relogement provisoire peut accen-tuer la dégradation de la santé mentale. Les incendies traumatisent enfants et personnels fragilisés car victimes ou témoins de destructions, comme ré-cemment dans l’Aude. Des cellules d’ac-compagnement de la santé au travail, physique et psychique doivent bénéfi-cier à des personnels impuissants face à la détresse d’enfants traumatisés alors qu’ils peuvent eux-mêmes souffrir de stress post-traumatique. Les responsa-bilités des personnels, souvent mal for-més, sont accrues. Des contradictions entre l’organisation de l’enseignement, notamment de l’EPS, et la mise en dan-ger potentielle de la santé des élèves sont sources de stress professionnel. La santé physique est également impactée. L’exposition à la chaleur entraîne un cumul de fatigue. Mais les adultes sont en mouvement et doivent rester concentrés et vigilants. Avec des volets fermés pour réduire le rayonnement solaire, la classe tient davantage de la garderie surchauffée, avec des extrêmes climatiques aujourd’hui autour de 40 degrés mais qui atteindront progressivement les 45. Dengue et chikungunya apparaissent dans l’hexagone du fait de l’arrivée d’espèces invasives porteuses de virus. Comment protéger une PE enceinte des risques de complications ? Enfin, des personnels peuvent présenter des facteurs de comorbidité qui les rendent vulnérables à la chaleur, d’au-tant qu’en responsabilité de classe, on peut oublier de s’hydrater soi-même.
COMMENT ADAPTER LE BÂTI SCOLAIRE ?
En fonction du réchauffement, la priorité au maintien de l’enseignement à l’école ne sera pas forcément toujours possible. L’école à distance – qui n’est pas de facto l’école à domicile - est à anticiper si les déplacements sont impossibles. L’adaptation du bâti doit absolument intégrer le confort d’été. Or il est rarement pris en compte dans les rénovations énergétiques. Il faut également adapter les extérieurs et les cours de récréation, notamment en végétalisant. Les rénovations partielles sont à éviter car chères et inefficaces. Installer des doubles vitrages ne sert à rien si les murs ne sont pas isolés. Des pièces réfrigérées sont nécessaires. Elles peuvent se situer dans des espaces tiers, comme une médiathèque, avec des temps intergénérationnels partagés avec des personnes âgées. Face au risque de coupure des réseaux, les écoles ont besoin d’une alimentation énergétique autonome. Ces aménagements constituent des investissements considérables pour les collectivités territoriales vers qui les crédits doivent être fléchés. Indispensable, la rénovation du bâti scolaire n’est toutefois pas suffisante, car l’école n’est pas une île indépendante des réseaux, des transports. L’adaptation de l’école doit donc s’inscrire dans une réflexion globale non seulement sur le bien-être des élèves, la santé au travail des personnels, le sens de l’enseignement mais aussi comme lieu de refuge en cas de catastrophe.
“Face à l’éco-anxiété des enfants, les personnels éducatifs sont démunis car eux-mêmes victimes du changement climatique”
Y A-T-IL D’AUTRES LEVIERS D’ADAPTATION ?
Probablement repenser les rythmes scolaires pour privilégier les matinées et finir les cours tôt avant le pic de chaleur. Les vagues de chaleur de plus en plus fortes en juin et en septembre contraindront de revoir le calendrier. L’articulation entre programmes, rythmes et calendriers scolaires est à interroger pour que l’accueil des enfants soit assuré les mois de forte chaleur – car beaucoup seront mieux à l’école qu’à la maison – mais pas forcément pour des apprentissages qui requièrent une concentration seulement possible quand la températures est modérée. La question du droit de retrait se pose avec acuité face au risque de mise en danger des élèves. Leur exposi-tion aux risques climatiques sur le temps scolaire entraine en effet une fragilisation juridique des personnels, face aux plaintes potentielles de parents d’enfants victimes d’hyperthermie dans des locaux surchauffés ou d’insolation lors d’une sortie scolaire. Le pacte éducatif et le métier sont mis sous pression. Il s’agit non seulement d’accompagner les enfants vers l’autonomie intellectuelle et citoyenne mais aussi de répondre aux besoins de sécurité. L’école n’est plus un espace intérieur protégé où on explique l’extérieur. Le changement climatique est dans l’école.
QUEL EST L’IMPACT DES ÉCO-GESTES ?
Les éco-gestes sont essentiels mais insuffisants. Ils procèdent trop souvent d’une logique moralisatrice et culpabilisatrice qui ignore à la fois les inégalités entre ceux qui ont le choix d’utiliser des options décarbonées et ceux qui ne l’ont pas, les structures économiques qui pèsent sur ces choix et la responsabilité des producteurs pollueurs. Ils rabattent sur l’individu les défaillances collectives. Trier les déchets, économiser l’énergie, ne pas gaspiller la nourriture sont des règles de vie en société importantes. Mais il ne faut pas qu’elles relèvent d’un catéchisme écologique qui empêche de ré-fléchir au sens des gestes et à la volonté. Car tout citoyen a le droit de faire ou ne pas faire. Mener un projet pédagogique interdisciplinaire intégrant l’éducation à la santé autour d’un jardin partagé, d’un compost ou d’un circuit de récupération de l’eau est plus fructueux. Cela participe à la construction d’un citoyen doté d’esprit critique qui comprend les choix et redonne sens au métier enseignant.
SUR QUOI AGIR EN PRIORITÉ ?
La meilleur adaptation reste l’atténuation. Tant que le « zéro émission net » n’est pas atteint, le climat continue de se réchauffer. Tant qu’on ajoute du CO2, on s’adapte à une cible mouvante. Le temps de mettre en place les solutions, elles sont déjà obsolètes. Le travail de décarbonation évite la mal adaptation : des solutions pensant régler le problème et qui l’aggravent, à l’instar d’occultants de vitre en plastique dont la production est émettrice de CO2. Les dépenses engagées sont efficaces quand elles prennent en compte une cible à +4 degrés. La prochaine génération d’élèves qui achèvera sa scolarité dans quinze ans vivra dans un monde à +2 degrés. L’été 2022, avec ses records de température, de sécheresse et d’incendies passera pour un été normal. Quand les jeunes PE d’aujourd’hui prendront leur retraite, ils garderont le souvenir d’un été frais. Nous avons à penser des solutions d’avenir dans un climat actuel qui n’existera plus. La politique climatique pour une école résiliente doit appréhender toutes ses missions. Assurer la protection et la formation des personnels. Interroger les finalités et contenus éducatifs selon les périodes et les caractéristiques climatiques des territoires. Réserver les apprentissages aux seules matinées dès 7h30, imaginer trois mois d’été sans enseignement mais avec d’autres activités ? Prendre en compte les enjeux d’inclusion mais aussi d’alimentation décarbonée et de menus adaptés aux saisons. S’inquiéter de la maîtrise des gestes qui sauvent et de comment se protéger des piqûres de moustique. Interroger l’égalité filles/garçons dans la façon de se vêtir lors d’une vague de chaleur. Et comment assurer les transports scolaires par 50 degrés ? Esquisser une autre organisation matérielle de la classe où il faut fréquemment s’hydrater et se rafraîchir. Les scientifiques donnent les trajectoires climatiques et leurs conséquences. Imposer ces questions dans le débat public revient à la communauté éducative.