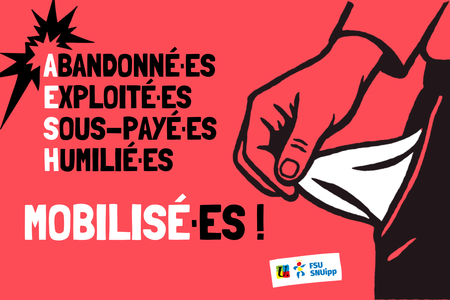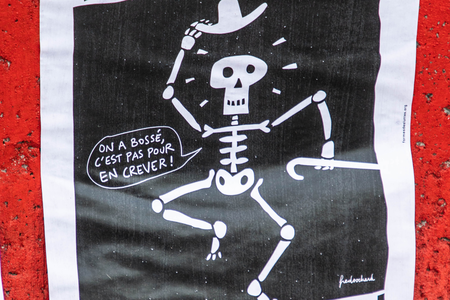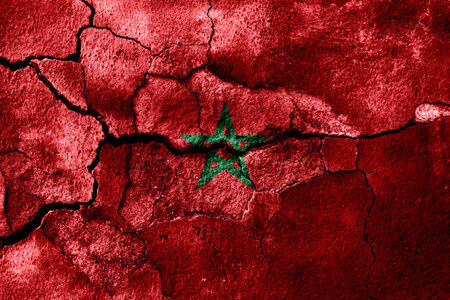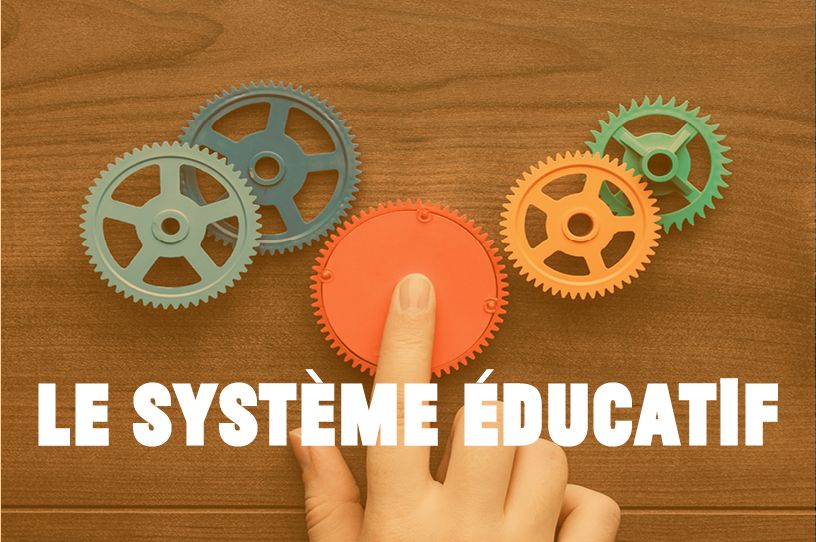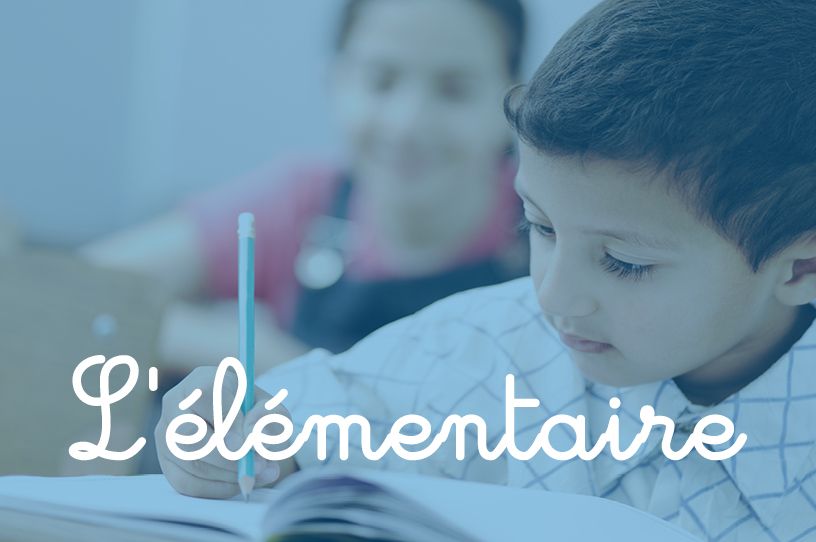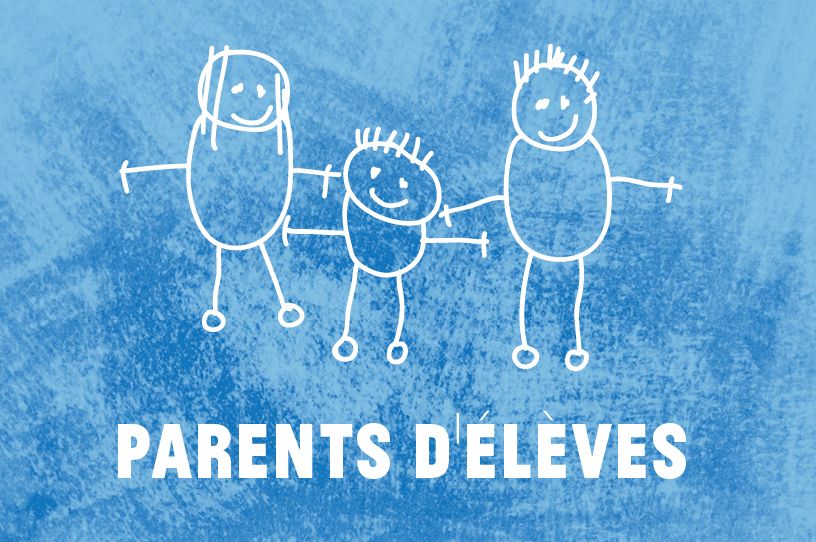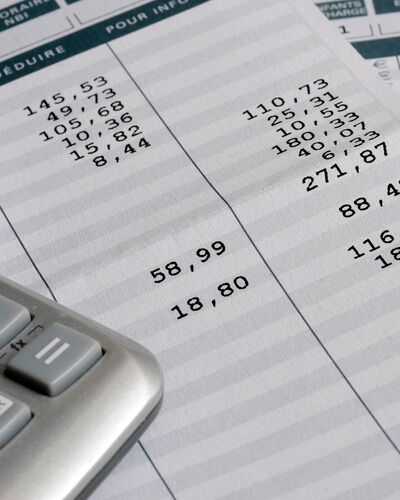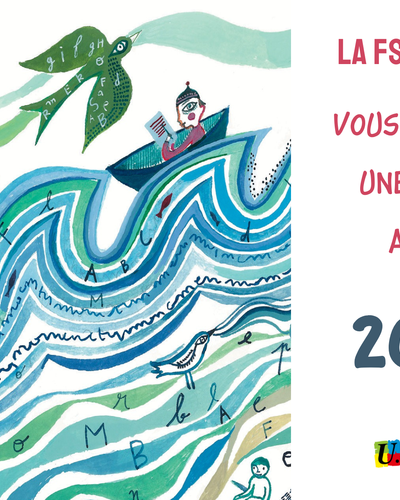“Ces inégalités de sollicitations sont récurrentes”
Mis à jour le 18.11.25
min de lecture
Selon les contextes d'enseignement, des écrits d’élèves témoignent de sollicitations cognitives différentes susceptibles de produire des apprentissages inégalitaires sur le long terme. Une prise de conscience s’avère nécessaire et devrait s’inscrire dans la formation.
Marion Van Brederode est chargée d'enseignement, dans le formation initiale des enseignant•es à l’université de Genève. Elle est co-autrice de Des difficultés curriculaires en classe de 6ème, Ed PUR.
 ©Hidalgo/Naja
©Hidalgo/Naja
EN QUOI L'ÉVOLUTION DES ATTENDUS OFFICIELS EN SVT PEUT-ELLE RENFORCER LES INÉGALITÉS ?
En étudiant les programmes ou les manuels depuis les années 60, on se rend compte que l’on est passé d’une capacité attendue à décrire les structures des êtres vivants, à une capacité à étudier les fonctions biologiques (comme la reproduction) puis du rôle de ces fonctions dans les relations entre divers organismes d’un écosystème. L’habileté cognitive majeure sollicitée était la mémorisation-restitution, elle est à présent de l’ordre du raisonnement, de la déduction, de la capacité à poser et à expliquer un problème.
Cette élévation des visées intervient parallèlement à la massification scolaire du secondaire, ce qui peut placer les élèves les plus éloignées de la culture scolaire en difficulté. Il ne s’agit aucunement de regretter ce changement, au contraire, mais l’école doit prendre en charge ces exigences cognitives, au risque, en les renvoyant vers le milieu familial, d’engendrer des inégalités d’appropriation des savoirs. De même, si on analyse la littératie scolaire (voir page 44 NDLR), les textes étaient autrefois linéaires appuyés d’images illustratives et sont aujourd'hui de plus en plus composites, avec des hétérogénéités discursives et sémiotiques. Leur sens de lecture et le lien entre tous ces documents ne sont pas donnés explicitement et doivent donc s’enseigner.
QUE RÉVÈLE L'ANALYSE DE CAHIERS D'ÉLÈVES DE SIXIÈME ?
On sait que les élèves n’interprètent pas les activités de la même manière, mais la question est aussi de savoir, sans jugement, si les sollicitations proposées par les enseignants sont égales. Or, les traces laissées dans les cahiers donnent à voir clairement deux différences. D’une part, en sciences comme en français, les bilans, les textes de savoirs, sont marqués par des différences selon les établissements. Dans les établissements accueillant principalement des élèves de milieu défavorisé, la majorité des écrits se situent sur « un savoir que », c’est-à-dire qu’ils ne donnent pas à voir les raisons et les nécessités qui sous-tendent les savoirs. Par exemple, les divers comportements des animaux en hiver sont nommés mais non rattachés à la question de la disponibilité en nourriture. Cette absence d’éléments explicatifs empêche les élèves de déconstruire leur représentation initiale liée au froid et de construire des savoirs transférables.
“Identifier les obstacles qui sous-tendent les savoirs”
QU’EN EST-IL DES SOLLICITATIONS SOCIO-LANGAGIÈRES ?
À gros traits, on pourrait dire que dans les établissements défavorisés les sollicitations restent à des demandes de descriptions de bas niveau ; alors que dans les établissements favorisés elles s’accompagnent d’un questionnement sur les conclusions possibles des résultats. Qui plus est sous la forme d’une réponse rédigée puis corrigée. Dans le second cas, du temps individuel pour penser et prendre en charge l’interprétation est donné aux élèves. En creux, dans le premier cas, on suppose que beaucoup de choses sont passées par l’oral, mais ce format de sollicitations est moins contraignant et souvent moins investi par les élèves en difficulté. Or, ces inégales sollicitations sont récurrentes. Cumulées, elles peuvent pénaliser durablement les élèves, créant des curriculums distincts.
QUELS SONT LES ENJEUX DE FORMATION DES ENSEIGNANT∙ES ?
Rappeler en préalable le postulat d’éducabilité. Puis bien distinguer les tâches des objectifs d'apprentissage : il y a souvent une confusion entre ce que l’on demande de faire aux élèves et les savoirs visés. Éclaircir les deux permettrait d'identifier les obstacles qui sous-tendent les savoirs et de mieux penser les situations, les étayages et les désétayages. Le moment du saut cognitif nécessaire dans un apprentissage n’est pas évident à identifier, pourtant il est indispensable de le travailler. Enfin, avoir une vigilance aux différenciations en place, pour éviter qu’elles soient une simplification qui entraîne un évitement d’exigences cognitives.