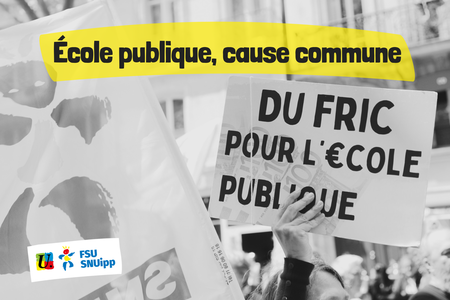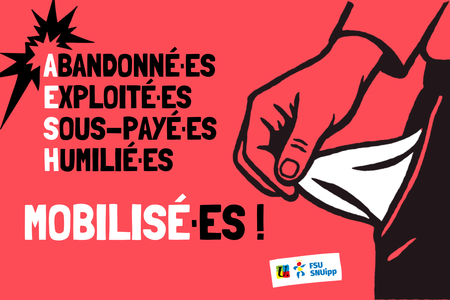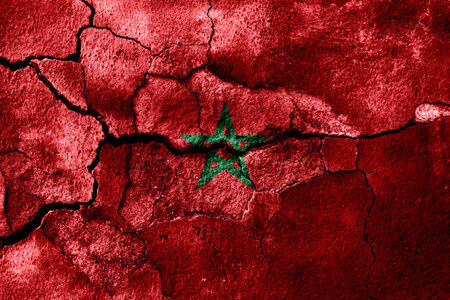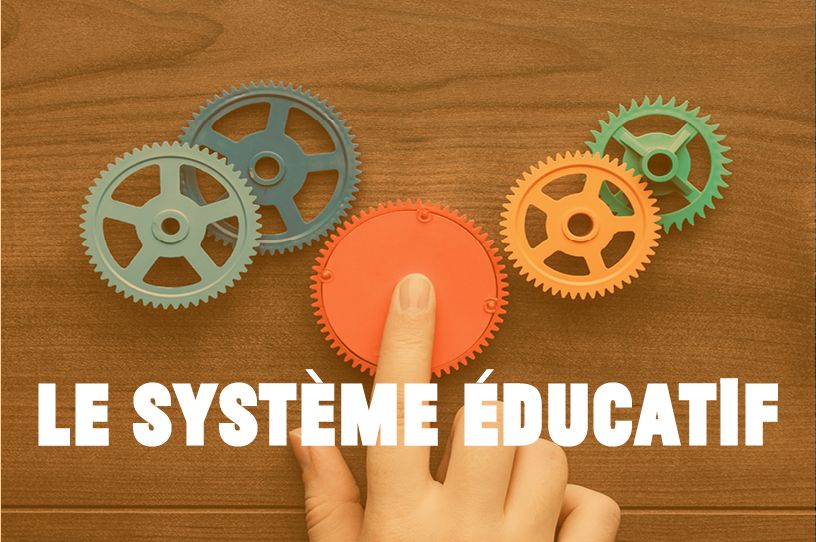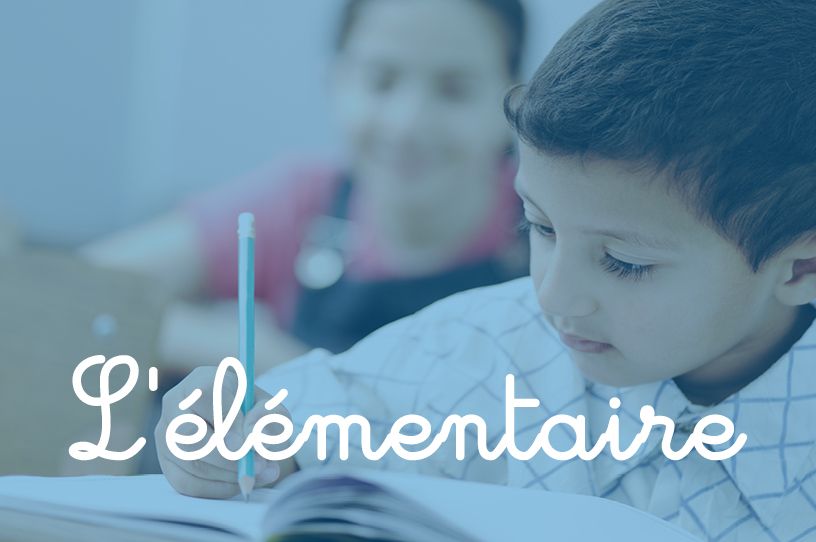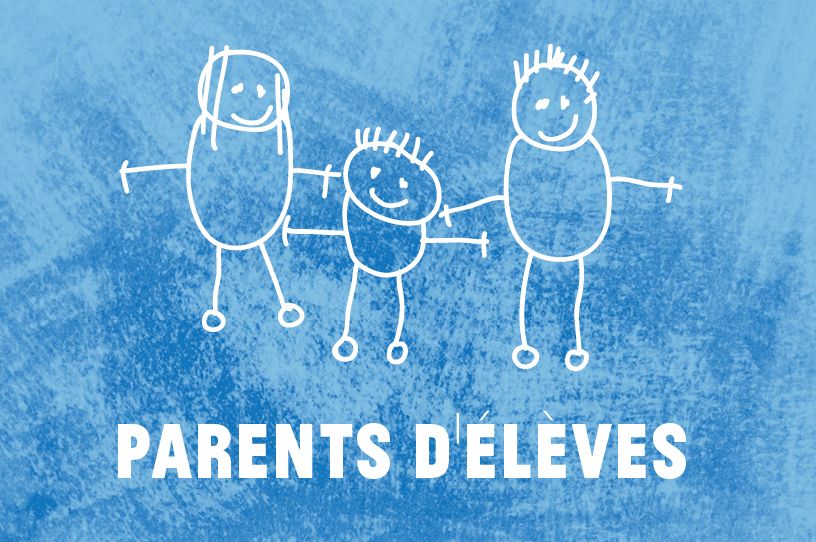Science à marée haute
Mis à jour le 29.08.25
min de lecture
Les CM1-CM2 de l’école Cauvin à Drap accèdent à la compréhension des conséquences de l’acidification des océans
« Sortir de l’injonction aux éco-gestes en traitant l’éducation au développement durable de manière scientifique », tel est le moteur pédagogique d’Anaïs Carlin, PE en pédagogique d’Anaïs Carlin, PE en pédagogique d’Anaïs Carlin, PE en charge de l’animation du du centre pilote La main à la pâte des Alpes-Maritimes. En cette matinée de début d’été déjà caniculaire, elle co-anime le déploiement d’un protocole expérimental consacré à l’acidifi cation des océans, dans la classe de CM1-CM2 d’Yves Le Scouarnec à l’école Cauvin (Rep+) de Drap, près de Nice.
Nourrie de projets scientifiques et artistiques menés à l’occasion de la récente réunion de l’UNOC* à Nice, cette classe cumule déjà de solides bases en matière de biodiversité marine et d’interactions écosystémiques. L’ouverture de séance est ainsi l’occasion pour Loïc de rappeler que « nous aspirons de l’oxygène et expirons du CO2 alors que les plantes respirent du CO2 et rejettent diaporama sur les secteurs économiques et les pays émetteurs de CO2 et sur la concentration atmosphérique du carbone depuis le début de l’ère industrielle constitue un second temps préliminaire au vif du sujet : « Quel effet produit cette quantité de CO2 émise sur la faune et la flore marines ? ».
L’OCÉAN DANS UN VERRE D’EAU
Une question pertinente qui permet de dépasser l’éco-anxiété suscitée par le diaporama qui « fait peur » à Amine. Les avis fusent. Fami est sûr de lui, « la mer monte beaucoup » et Pedro s’alarme du fait que « les poissons meurent tous » mais Malika pense que « le CO2 c’est bien pour que les plantes respirent mieux »… Les expressions spontanées ne relèvent pas encore du registre de l’hypothèse. Selon Anaïs Carlin, « faire verbaliser les représentations initiales des élèves est nécessaire pour mieux les déconstruire à l’issue du processus expérimental ».
Dans cette phase critique de réflexions et d’expression orale, la précision langagière est requise. Pour l’enseignant, c’est aussi « le moment d’écarter les formulations morales pour inviter à se concentrer sur les faits à observer ». Au fil des échanges se dégage l’ambition partagée, résumée par Serena, de « faire une expérience, comme au collège » pour reproduire en classe les effets de la concentration du CO2 dans l’eau de mer. Reste à concrétiser les intentions des Marie Curie en herbe.
Comment injecter du CO2 dans l’eau de mer ? Leïla ne tarde pas à trouver l’astuce : « Souffler dedans avec une paille ! ». Et comment observer ce que cela change ? Le questionnement est alors guidé par Anaïs pour « aider à comprendre qu’en démarche expérimentale, il faut toujours comparer à une donnée témoin ». À l’enthousiasme d’enrichir le verre-test d’air expiré succède la frustration de n’observer ni changement de couleur, ni d’odeur… bientôt surmontée par la mesure d’écart de PH entre l’eau de mer brute du verre témoin et celui d’une H2O de plus en plus « acide » à mesure qu’on y injecte du CO2.
Une première institutionnalisation inscrit les observations mathématiques dans un rigoureux argumentaire. Les connaissances se dégagent pour éclairer un enjeu complexe d’actualité : l’acidification croissante des océans. Un processus de construction des connaissances par les élèves d’une portée bien supérieure à la seule lecture d’informations. « La découverte de ces problématiques sur un document oblige à faire confiance, insiste Yves. Or, les élèves fréquentent les réseaux sociaux et mettent en doute le statut des documentaires scientifiques. À travers la manipulation et les constats réalisés dans l’expérience, ils accèdent à la preuve scientifique irréfutable ».
APPROCHE SENSIBLE
La réplique expérimentale des effets de l'acidification de la mer ne tarde pas à ouvrir le champ des questions éthiques et citoyennes dans le rapport au vivant. Des coquillages vides (« pour ne pas faire mal aux animaux ») sont plongés dans des solutions vinaigrées. Stupeur ! « L’eau se trouble », « des bulles remontent en surface », « la coquille fond ! », « elle se décompose, se dissout »… Les déductions fondées sur les observations reconstruisent bientôt le puzzle : non seulement le CO2 rend la mer plus acide, mais une acidité élevée porte atteinte à la faune marine. Celle-là même que les élèves ont tant pris plaisir à représenter dans toute sa diversité sur une affiche réalisée pour une exposition de l’UNOC.
Une prise de conscience collective sur la détérioration de la Méditerranée d’autant plus sensible selon Yves que « la mémoire de l’expérience est plus forte et plus stable ». Et de quoi donner raison au parti-pris scientifique initial d’Anaïs : « Pour acculturer les élèves aux effets du réchauffement climatique, il vaut mieux éviter les informations brûlantes et décourageantes. Les élèves tirent mieux profit d’une reproduction de ces phénomènes dans de petites expériences qui les confrontent à des faits éprouvés ».
*Conférence des Nations Unies sur l’océan.
Interview d'ANGE ANSOUR
Co-fondatrice et directrice de l’* Association française pour l’éducation par la recherche (AFPER)

QUELS CONSEILS POUR LES PROGRAMMES DE SCIENCES DE 2023 ?
Ces programmes du cycle 3 recèlent un nombre important de notions à aborder. La suppression de la technologie en 6e a entraîné une bascule du numérique et de la robotique vers le CM. L’accent reste globalement mis sur la démarche expérimentale. Il paraît toutefois diffi cile de tout traiter dans les temps impartis, ce qui impose de faire des choix, sans tomber dans le morcellement au risque de survoler et de s’épuiser. Plutôt s’en remettre à son identité professionnelle de pédagogue sans spécialité disciplinaire pour combiner les notions dans une démarche de projets. Lire, comprendre, enquêter en constituent la matrice.
COMMENT ABORDER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
L’éducation au développement durable, le rôle citoyen et prospectif des sciences sont désormais pris en compte. Mais la perception du réchauffement climatique peut exacerber les sentiments et les conflits de loyauté entre école et famille. Répliquer les phénomènes à l’échelle de la classe aide à comprendre que le savoir scientifique n’est ni une opinion, ni une simple information. Mais dégager des consensus sur les solutions reste une question vive. Les élèves doivent maîtriser leurs fondements scientifiques pour arbitrer entre elles avec humanisme, en argumentant et en évaluant leur acceptabilité.