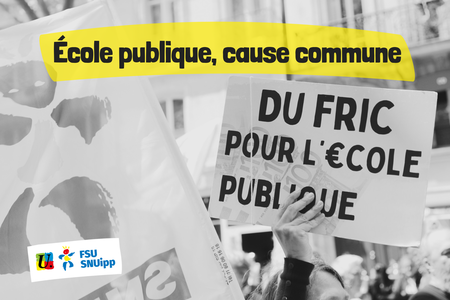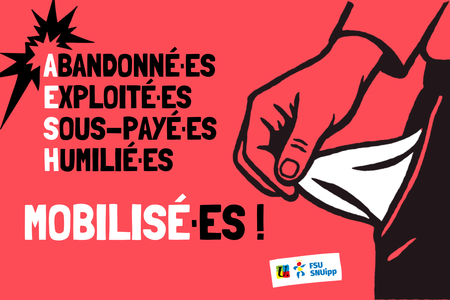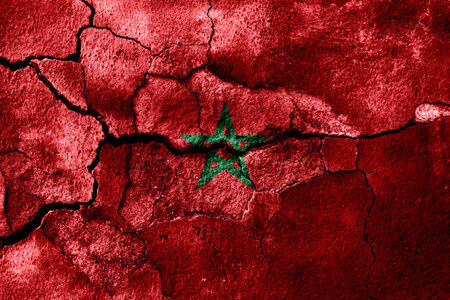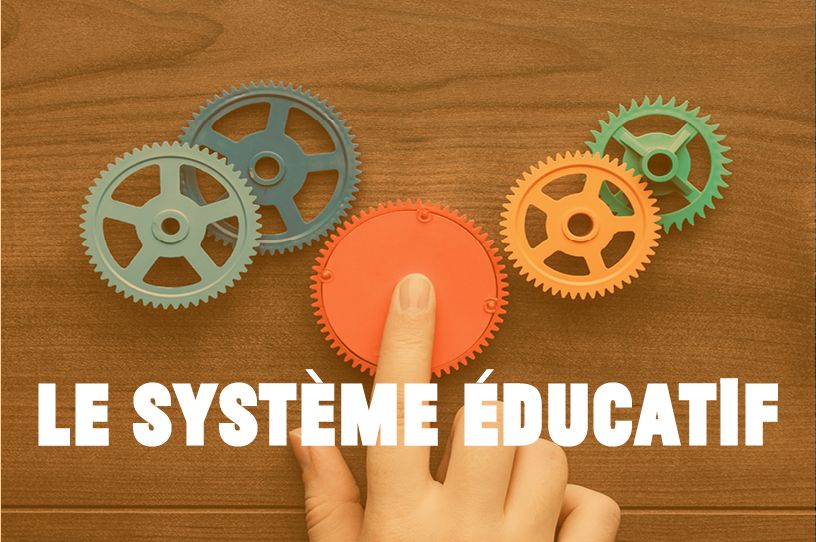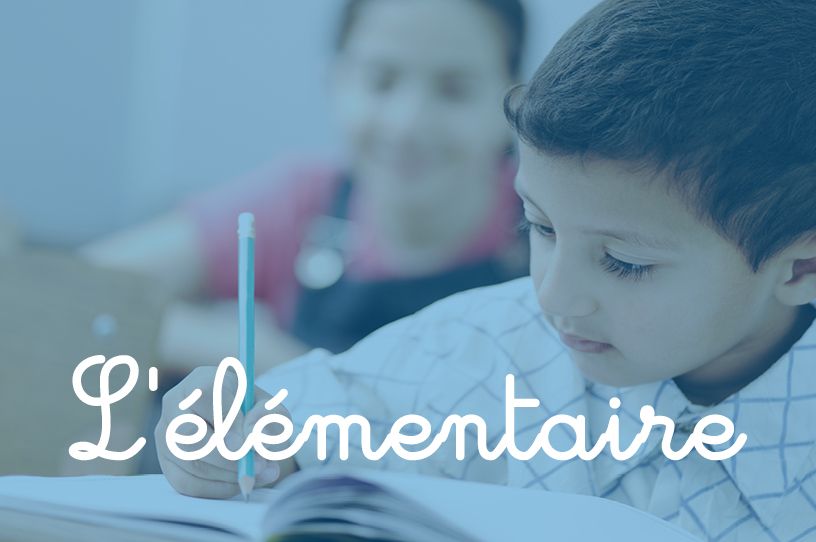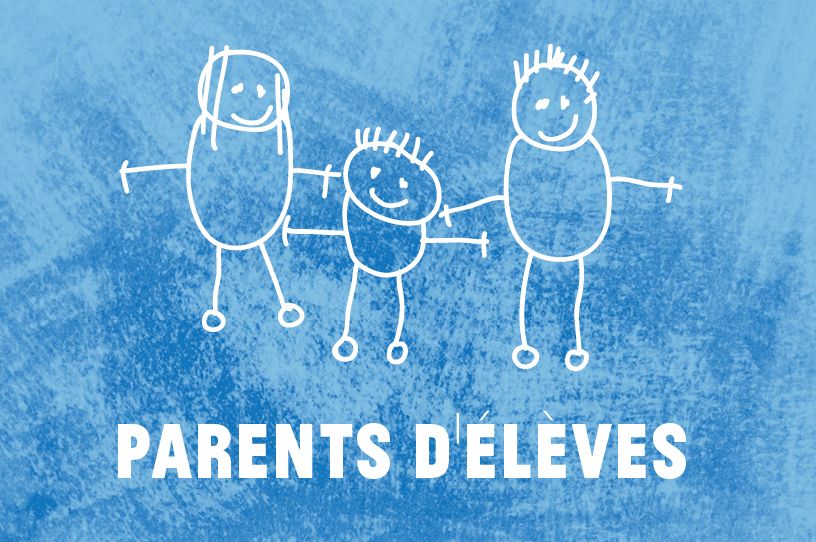Pêche industrielle, exploitations plurielles
Mis à jour le 29.08.25
min de lecture
Désastre écologique, le chalutage porte également atteinte au travail et aux droits humains.
« Tous les êtres humains dépendent directement ou indirectement de l’océan ». Cette alerte du GIEC* rappelle que 50% de l’oxygène terrestre et 70% de protéines consommés dans certaines régions d’Afrique, proviennent de la mer. Or, les réserves halieutiques d’Afrique de l’Ouest sont en cours d’épuisement, pillées par des bateaux-usines parmi les milliers qui parcourent les océans. Équipés de chaluts grands comme deux fois la tour Eiffel, ces navires peuvent pêcher en une journée jusqu’à 250 tonnes de poissons, soit autant que 50 petits bateaux de pêche artisanale en un an.
Cette surpêche menace l’auto-suffisance alimentaire et détruit les emplois de pêcheurs locaux. Contraints de migrer, nombre d’entre eux s’embarquent sur les chalutiers qui les ont ruinés. Sur les ponts des flottes industrielles naviguant en eaux internationales sous pavillon de complaisance pour mieux échapper aux législations étatiques du travail, le sort des marins est cauchemardesque : passeport confisqué contre travail forcé, conditions de travail inhumaines proches de l’esclavage, violences physiques et sexuelles…
TOUT EST DANS L’ASSIETTE
À l’autre bout de la filière du chalutage de fond, la situation des travailleuses des usines de transformation des produits de la pêche n’est guère plus enviable. Dans des conditions d’hygiène déplorables et de restrictions de liberté, ces femmes produisent des farines animales destinées aux élevages en Occident. Il n’est pas rare que les rejets chimiques de ces sites industriels polluent les eaux côtières pénalisant toujours plus la pêche artisanale.
Menace pour la biodiversité et « bombe climatique », le dragage des sédiments marins détruit les écosystèmes qui capturent le carbone et le chalutage industriel engloutit, en outre, les subventions publiques dont dépend sa rentabilité. En bout de chaîne, la composition de l’assiette des consommateurs occidentaux, souvent bernés par des labels de pêche durable, en réalité non contraignants, et des prix bas, reste le meilleur moyen de peser sur les États pour légiférer et empêcher l’exploitation du vivant, marin comme humain.
* Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.