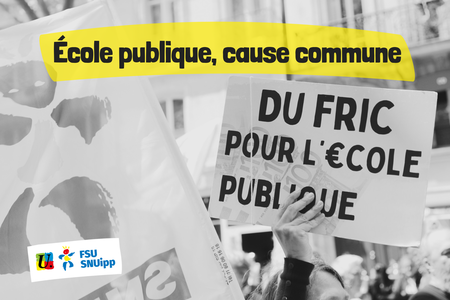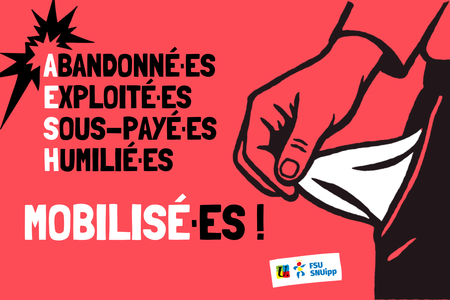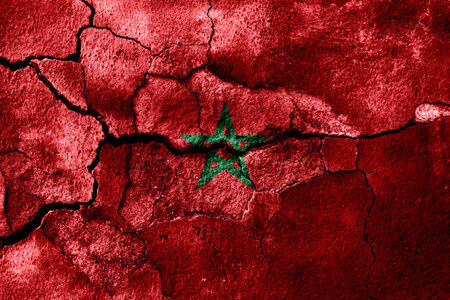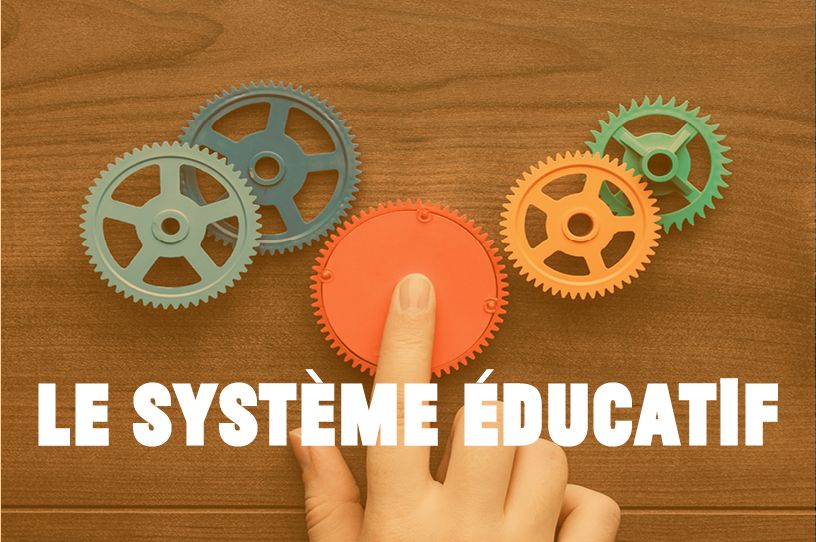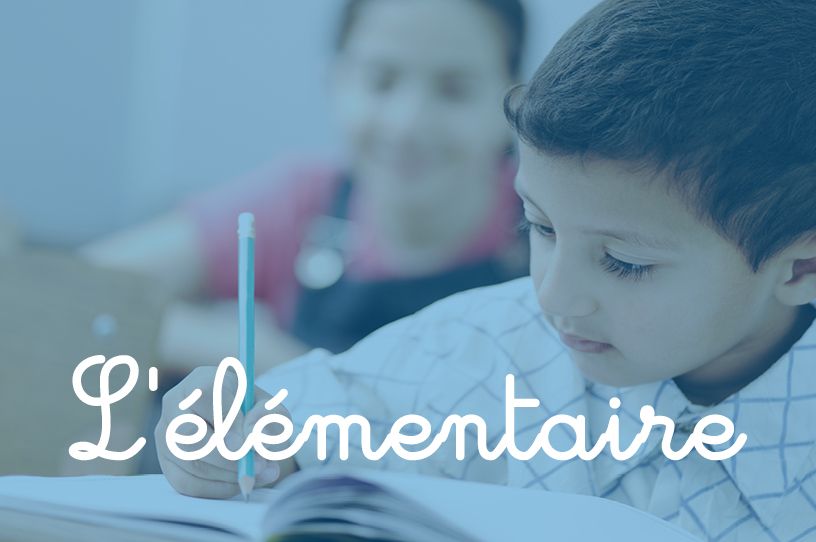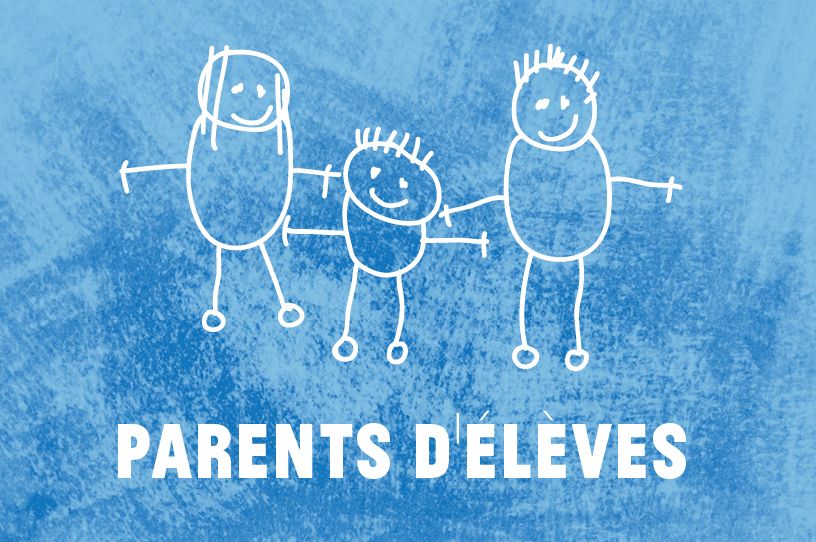MAIS QUEL ENSEIGNEMENT EXPLICITE ?
Mis à jour le 26.09.25
min de lecture
L’enseignement explicite a le vent en poupe. D’une façon assez détournée de sa fonction originelle « apprendre, comprendre, construire. »
L’enseignement explicite a le vent en poupe. D’une façon assez détournée de sa fonction originelle « apprendre, comprendre, construire. »
La première phrase des principes des nouveaux programmes de cycle 2, en français et en mathématiques, pose « l’établissement de savoirs fondamentaux dans le cadre d’un enseignement explicite […] ». Une modalité d’enseignement fortement conseillée pour l’école élémentaire, appuyée par des formations, conférences, injonctions dans plusieurs académies ou encore un guide dit de « Synthèse de la recherche et de recommandations » du Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN). Des documents qui proposent une interprétation très réductrice de la notion. Pourtant, deux principales acceptions de cette formule ont des degrés différents d’exigences.
MODELAGE ET ENTRAÎNEMENT
L’enseignement explicite prôné actuellement dans l’institution se réfère à un modèle didactique popularisé par le professeur d’université canadien Steve Bissonnette, en lien avec les travaux du chercheur néo zélandais John Hattie pointant l’importance d’une programmation méthodique de l’enseignement. Cette démarche, renvoyant à « l’instruction directe » – même si cette filiation est parfois passée sous silence ou rejetée – se caractérise par une activité focalisée sur l’acquisition d’une connaissance ou compétence, partant du principe que l’on apprend du plus simple vers le plus complexe.
Elle se structure autour de trois grandes phases récurrentes : le modelage, le guidage puis la pratique autonome. L’enseignante ou l’enseignant expose les notions à apprendre, montre en détaillant les étapes de réalisation ; puis il dirige et accompagne par des questionnements et des rétroactions avant que les élèves s’entraînent sous sa supervision. Présentée comme « efficace », dans un rythme soutenu de séances, elle se réfère aux données probantes (« evidence based ») mais dont les résultats « concernent majoritairement le processus de mémorisation, parce que cela touche des opérations automatisables » selon Sylvain Connac, chercheur en sciences de l’éducation (Cahier pédagogiques, mars 2024). Cette démarche se décline parfois comme un outil parmi d’autres, selon les situations ou disciplines, parfois comme une vision globale de l’enseignement tout entier confiné à ce modèle de séquences.
DÉVOILER LES ENJEUX D’APPRENTISSAGE
Une autre conception, dans la continuité des travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, souligne qu’une tâche réussie ne signifie pas forcément une compréhension des savoirs. En prolongement, la didactique des disciplines cible l'identification des raisons des difficultés d’apprentissage et pose l’enseignement explicite comme la nécessité de travailler dès la maternelle sur des procédures incontournables : catégorisation, repérage dans l’espace, phonologie, compréhension de l’implicite…
Pour la docteure en psychologie de l’enfant Sylvie Cèbe, il s’agit de « ne pas considérer comme acquises des connaissances et des compétences qui ne le sont que par une minorité d’élèves » et de « susciter les réflexions de l’élève sur les enjeux de l’activité, sur ce qu’elle permet d’apprendre, de comprendre, de construire et pas seulement sur sa réalisation » (FSC n° 432). Elle appelle à consacrer un temps suffisant à la verbalisation collective guidant l’action, la définition des enjeux de l’activité ou des critères de réussite. Il s’agit alors d’une démarche tenant compte des réinterprétations des tâches, d’explicitation des attentes en levant les malentendus dans un objectif de démocratisation des savoirs.
Interview de JEAN-YVES ROCHEX
Jean-Yves Rochex est psychologue et chercheur en sciences de l’éducation, laboratoire ESCOL.
 crédit photo : DR
crédit photo : DR
QUELS MALENTENDUS S’AGIT-IL D’EXPLICITER ?
La construction des difficultés et inégalités scolaires repose pour une part importante sur une sorte de délit d’initiés, le système éducatif exigeant implicitement de tous les élèves, voire de leur famille, qu’ils aient ce qu’il ne leur donne pas explicitement. Trop souvent, l’enseignant, consciemment ou non, présuppose des élèves qu’ils puissent tous tout faire quasi « naturellement ». Passer de l’explication donnée à un travail ou une production autonome, de la manipulation à la conceptualisation, reconnaître les enjeux d’apprentissage au-delà de la succession des situations et des tâches, tirer une règle ou des enseignements généraux d’une observation, d’une comparaison ou d’un classement d’objets ou de phénomènes particuliers, se situer dans le registre de vocabulaire et de langage requis pour cela…
Ces changements sont souvent laissés à la charge des élèves, ou effectués par le maître sans que celui-ci soit assuré que tous les élèves le suivent alors que ce n’est le cas que d’une partie d’entre eux, ceux qui y sont préparés par leur famille. De même, il ne suffit pas pour les élèves de restituer la leçon, de réussir les tâches ou d’être engagés dans la réalisation de projets pour en comprendre les enjeux d’apprentissage et être à même de les réinvestir dans d’autres situations. Ce hiatus peut être source de graves malentendus s’il ne fait pas l’objet d’un travail explicite en classe.
QUELLES PRATIQUES ?
Ces malentendus peuvent être renforcés par des modes d’adaptation aux difficultés, réelles ou supposées, des élèves, qui conduisent soit à proposer des tâches de plus en plus restreintes ou morcelées, qu’ils peuvent réussir les unes après les autres sans qu’un réel apprentissage en résulte, soit à habiller les tâches pour les rendre plus attractives mais en rendant ce faisant plus difficile la perception des enjeux d’apprentissage.
Dès lors, traquer les implicites et malentendus est bien moins affaire de « bonnes pratiques » mais de vigilance partagée, individuelle et collective, didactique et sociale, s’efforçant de « concilier les acquis des pédagogies actives avec les exigences des pédagogies explicites et structurées »* et d’œuvrer à faire que les élèves puissent reconnaître – dans les deux sens du mot – l’enjeu d’apprentissage au-delà de l’effectuation des tâches et de la succession des situations.
* L’expression est du chercheur Roland Goigoux.