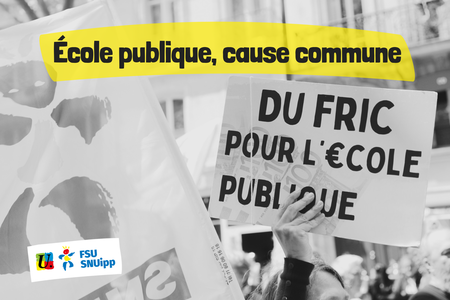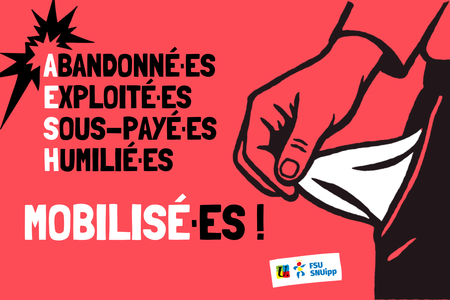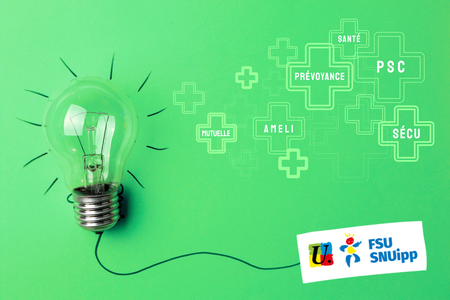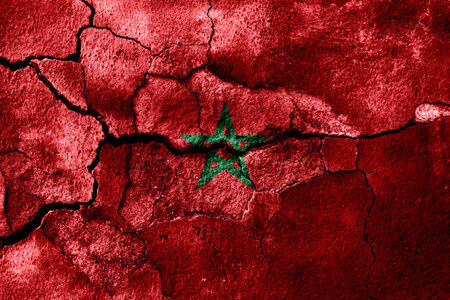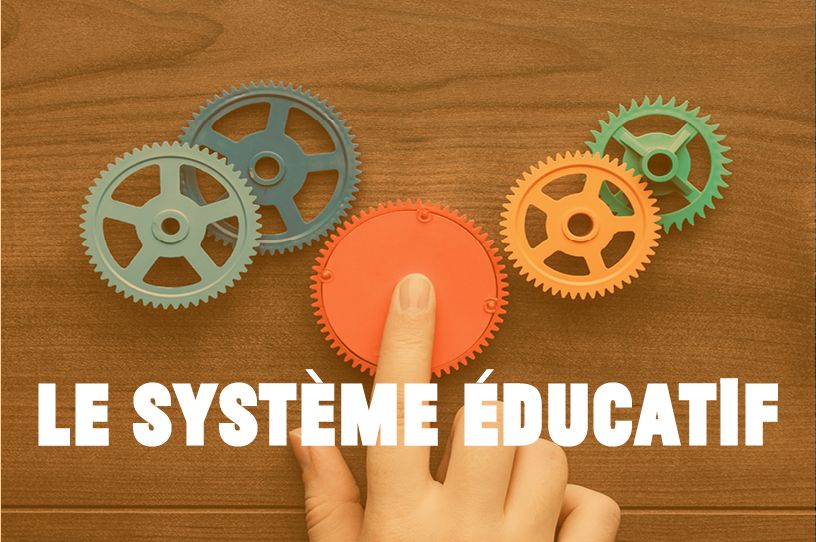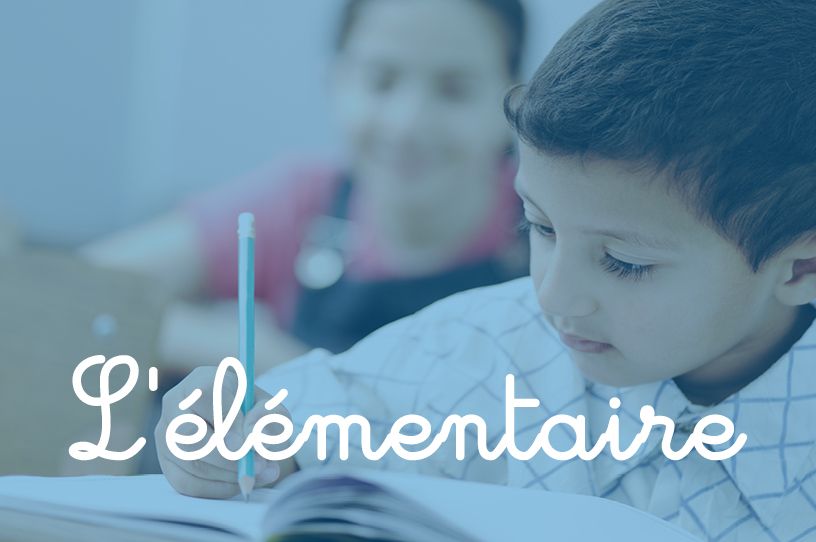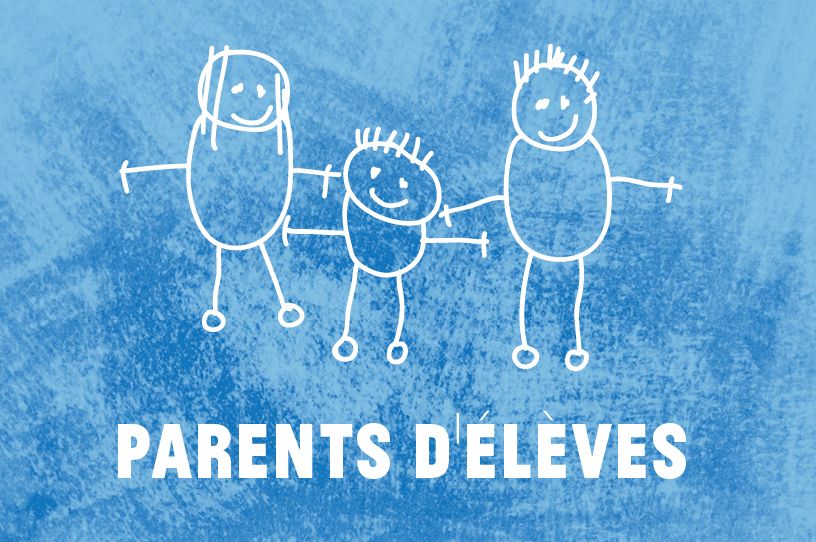“Les discours brouillent le message”
Mis à jour le 28.11.25
min de lecture
Interview Pierre Eysseric sur la résolution de problème
PIERRE EYSSERIC est agrégé de mathématiques
 ©DR
©DR
QUELLES DIFFICULTÉS DANS L’ENSEIGNEMENT DES MATHS ?
C’est d’abord une question de malentendus qui s’installent entre élèves et PE à propos de l’usage des symboles mathématiques. Utiliser les symboles, tels que le signe +, ne signifie pas que l’on comprend le sens de l’addition. Cela peut rester une simple représentation iconique d’une action réalisée, issue parfois d’une forme de dressage. Or, depuis plusieurs années l’institution renforce ce risque. Alors que les programmes ont abandonné légitimement le paradigme de la comptine numérique pour celui des décompositions des nombres, les discours brouillent le message.
De même, l’introduction précoce de la notation fractionnaire : lorsqu’un élève associe l’écriture 1/8 à une part de pizza, ce n’est souvent pour lui qu’une représentation de l’action de partage et non le résultat de cette action, et encore moins un nombre. En géométrie, il existe une confusion entre dessin et géométrie qui est entre autres liée à une focalisation sur l’utilisation soignée des instruments aux détriments des savoirs géométriques. Mais le nœud des difficultés reste la capacité d’utiliser des savoirs mathématiques dans la résolution de problèmes, ce passage de l’étude d’un objet mathématique à son utilisation comme outil de résolution, loin d’une récitation de savoirs.
QUELS OBSTACLES DANS CE DOMAINE ?
La connotation du terme constitue un premier obstacle. Dans le langage courant, un problème renvoie à une notion de difficulté alors qu’en mathématiques il s’agit d’un questionnement didactique moteur pour avancer, comme une gageure. Ce hiatus peut bloquer certains enfants. Il existe également parfois une confusion dans les pratiques entre exercices et problèmes. Si je résous le problème avec une technique académique toute prête, ce n’est plus un problème !
Un problème est là pour obliger à essayer, pour apprendre à chercher. Cela implique d’encourager ce temps, en particulier la possibilité de se tromper sans dramatisation. C’est en lien aussi avec la place donnée à la manipulation. Avec deux extrêmes : son absence privant les élèves d’un outil de représentation de la situation ou au contraire la seule manipulation avec une résolution pratique (souvent coûteuse) sans mathématiques.
QUELLES PRATIQUES ÉGALITAIRES ?
Trouver une juste place pour la manipulation en liant celle-ci à des contraintes empêchant la résolution du problème par la seule manipulation avec un place importante pour la verbalisation. C’est elle qui permet de réfléchir les actions réalisées, de les penser et donc de passer à l’abstraction mathématique. En évitant a contrario une plongée dans un langage abstrait qui souvent n’est qu’une manipulation de signes sans sens associé pour les élèves.
Travailler les problèmes dits atypiques pour apprendre à chercher -à condition d’expliciter ce que l’on a appris- n’est pas une perte de temps, même s’ils ne débouchent pas sur un savoir sur le nombre. Évidemment, la question de la formation entre en jeu. Il importe de créer des espaces de création et de liberté professionnelle en offrant aux PE, dès la maternelle, des temps communs pour réfl échir et produire.
A lire également dans ce dossier
- Le genre en mode mineur : éclairage avec le rapport "Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles" (IG)
- D'égale à égal : reportage en CE1 en plein coeur du XVe à Paris
- A tout problème, des solutions : reportage au sein d'une équipe pédagogique girondine
- "Aucune différence entre filles et garçons" : interview de Clémence Perronet, sociologue