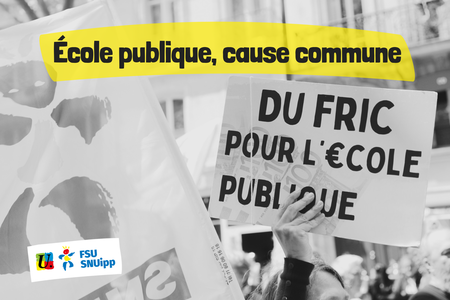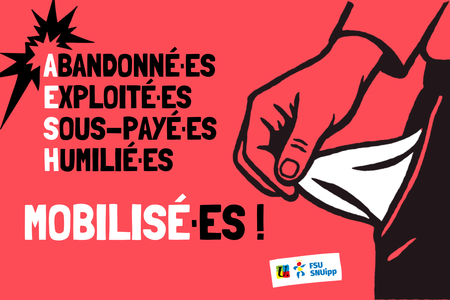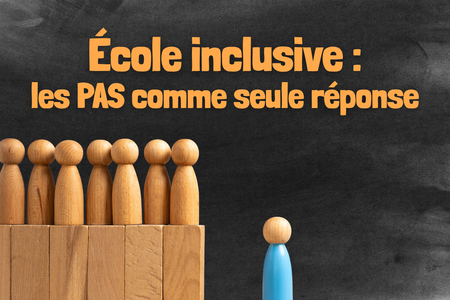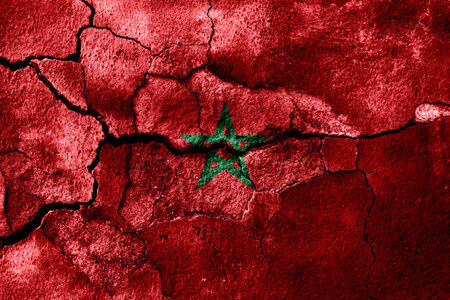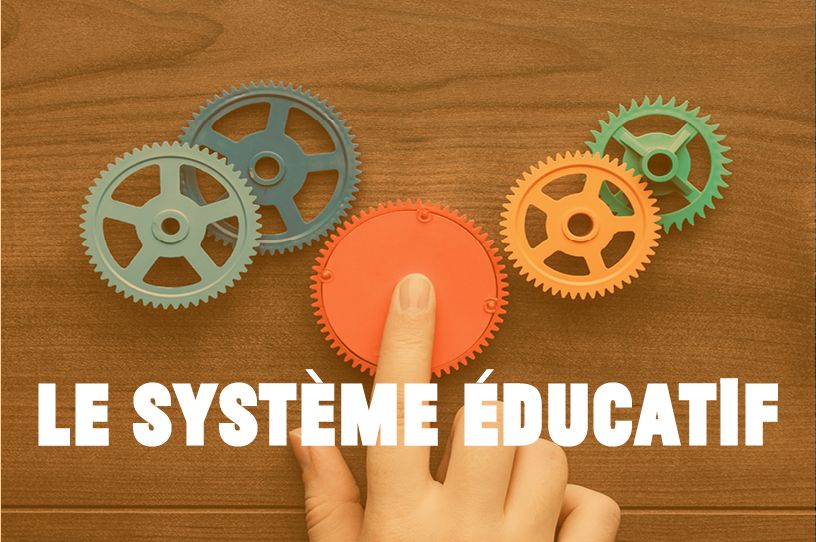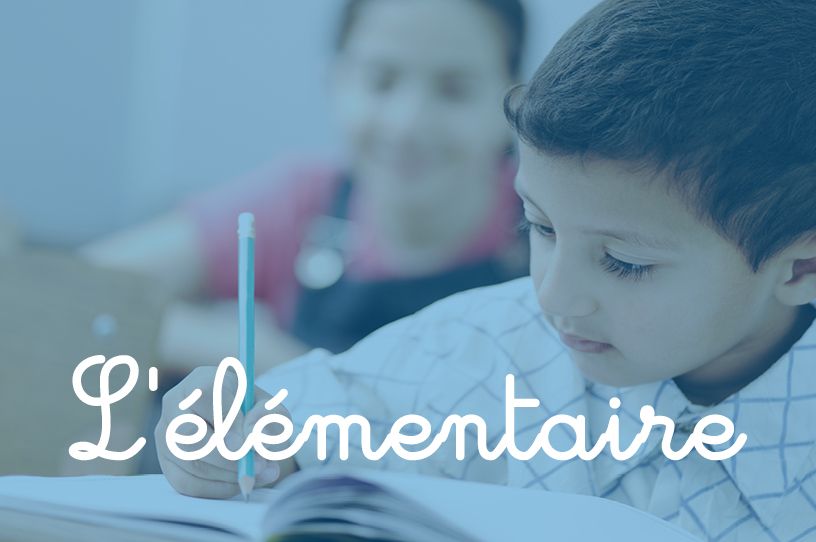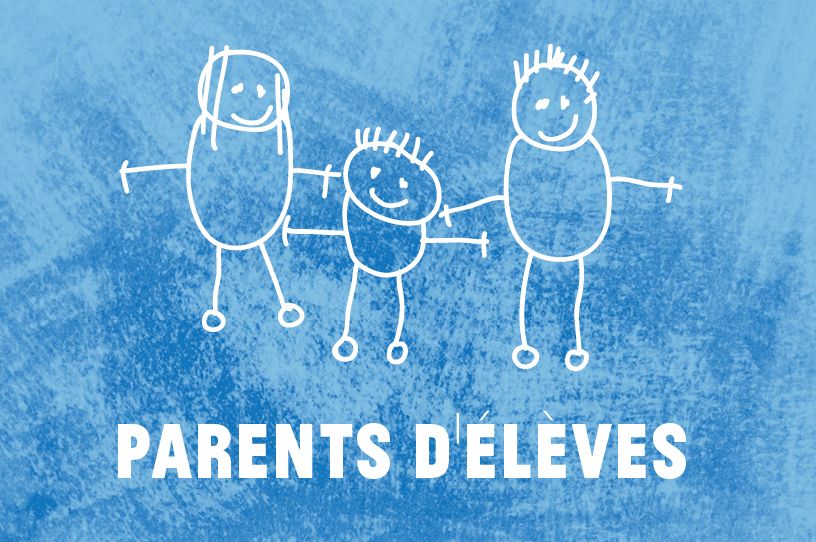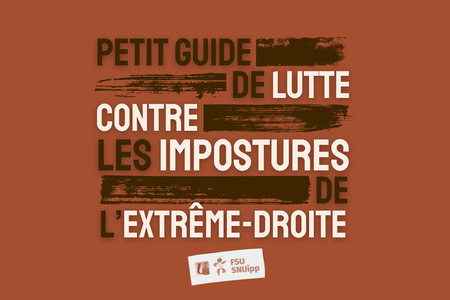EVARS : contres vérités sur les programmes
Mis à jour le 17.05.25
min de lecture
Adopté le 30 janvier dernier, le programme EVARS fait l’objet d’une offensive réactionnaire. Ces campagnes s’appuient sur des mensonges et autres Fake News. Afin de répondre aux inquiétudes, qui peuvent être légitimes, des parents, la FSU-SNUipp rétablit la réalité telle qu’elle est inscrite dans le texte et incarnée dans les pratiques enseignantes.
#
1- A l’école primaire on parle de sexualité : VRAI et FAUX ! #
Si la question est de savoir s’il s’agit d’explorer les relations sexuelles entre adultes, alors l’école primaire ne parle pas de sexualité. Pour rappel, la majorité sexuelle en France est à 15 ans, il n’est donc pas question pour les enfants de l’école primaire d’aborder ces questions stricto sensu.
Par contre, les enfants ont des comportements sexuels de découverte dès leur plus jeune âge qui sont naturels. Ces comportements ne sont pas honteux ni à interdire, mais nécessitent des apprentissages autour de notions telles que l’intimité, le respect de son corps et de celui d’autrui, le consentement, …
Le rôle de transmission des parents et des enseignant·es en co éducation consiste à tout mettre en œuvre afin de permettre aux enfants de s’épanouir, de se respecter, de respecter les autres, de se protéger et se confier si nécessaire.
En revanche, si le programme ne contient pas formellement le terme de sexualité, celle-ci est abordée explicitement en cycle III à travers l’identification de la dimension biologique de la sexualité humaine et distinction de ses autres dimensions (psycho-émotionnelle, juridique et sociale) et la reproduction humaine.
Enfin, sans parler de sexualité adulte, les relations amoureuses sont abordées dans le respect de l’égalité de considération et de dignité, que ces relations soient hétérosexuelles, bisexuelles ou homosexuelles.
2- Le programme va à l’encontre de l’intérêt des enfants et du droit des enfants : FAUX
#
Selon les données de la CIIVISE, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, ce qui représente 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 13. La plupart de ces violences sont commises dans un cadre intrafamilial. Ces chiffres montrent que les enfants ont un réel besoin de protection, d’abord dans leur famille mais aussi par l’Etat qui ne remplit pas son rôle actuellement. L’école doit y participer mais elle n’en a pas les moyens.
Non seulement, le programme EVAR ne contrevient pas au code pénal, pas plus que les enseignant·es qui ont à le mettre en oeuvre mais au contraire, la CIDE affirme que chaque enfant doit être protégé·e « contre toute forme de violence, [...] y compris la violence sexuelle » (art. 19 et 34). Cette convention assure le droit des enfants à « jouir du meilleur état de santé possible », ce qui passe par « l’éducation et les services en matière de planification familiale » (art. 24), tout comme le fait de « préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit […] d'égalité entre les sexes […] » (art. 28). Enfin, elle prévoit que chaque enfant puisse « exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » (art.12).
Par ailleurs, au-delà de la nécessaire lutte contre les violences, favoriser les relations saines, qu’elles soient amicales ou amoureuses, contribue à permettre à chacune et chacun de grandir en sécurité, de développer son pouvoir d’agir et d’acquérir des habitudes favorables à sa santé et son bien-être.
3- Le contenu du programme n’est pas adapté à l'âge des enfants : FAUX
#
Tout au long de la scolarité, le programme EVAR à l’école primaire/ EVARS au collège/lycée, repose sur trois principes : l’unité, la progressivité, la complémentarité. L’unité impose des axes de travail identiques au fil des apprentissages. La progressivité implique que les apprentissages se font en fonction de l’âge et de la maturité des enfants, avec un programme adapté en termes de connaissances, de vocabulaire et de réflexivité demandé aux élèves.
La complémentarité favorise une mise en œuvre du programme pensée et faite de manière interdisciplinaire, articulée avec le parcours de santé, le parcours de citoyenneté, la lutte contre le harcèlement et contre les discriminations, ainsi qu’avec le contenu des autres enseignements qui doivent contribuer à enrichir les connaissances.
Ainsi la connaissance du corps n’abordera à l’école maternelle que les organes génitaux externes et de la même manière les mots “du dictionnaire” seront appris par les enfants sans qu’il soit question d’autre chose que de savoir les nommer et utiliser les termes en cas de besoin.
Nous devons avoir en tête que des mots comme pénis ou zizi ont la même valeur pour les enfants dans la mesure où ils sont prononcés par les adultes sans tabous et sans interdits. Pour ce qui est du mot vulve, il n’a pas de “petit mot” équivalent commun à toutes les familles ce qui met les filles encore plus en difficulté que les garçons pour en parler y compris lorsqu'il s’agit d’exprimer un problème de santé.
Quant aux relations sexuelles encore une fois, elles ne sont pas abordées stricto sensu en dehors de la reproduction humaine au cycle 3 comme c’est le cas depuis 50 ans ou lorsqu’il sera question de protection contre les dangers d’internet en CM2. Là encore il ne s’agit que d’en parler afin de protéger les enfants et de leur permettre de s’en protéger ou de faire appel à un·e adulte de confiance en cas de besoin.
4- Le vocabulaire correspondant aux parties intimes est inadapté aux enfants : FAUX
#
Les parents apprennent facilement aux enfants les noms des différentes parties du corps à l'exception des noms des parties intimes (vulves, pénis, vagin, clitoris, gland, anus, …). Mais pourquoi ces mots seraient moins accessibles et même seraient problématiques pour les enfants ? Qu’en pense les personnels de santé (pédiatres, psy, …) ? Françoise Dolto disait “Il faut donner à l'enfant le véritable nom de son sexe. Et désigner les organes sexuels de façon positive.” C’est finalement en n’utilisant pas ces mots ou en en interdisant l’utilisation aux enfants que les adultes créent des tabous autour d’eux. Les enfants, surtout quand elles et ils n’ont pas construit “ces tabous”, les emploient de la même manière que les mots “oreille, pied, ventre”... Les apprendre et les utiliser dès la maternelle, c’est surtout permettre aux enfants de ne pas créer de tabous autour, de comprendre, par exemple, ce que les médecins peuvent leur dire, mais aussi leur permettre de les utiliser pour décrire une douleur, poser une question, dire qu’elles/ils ont mal ou dénoncer une violence sexuelle.
5- La responsabilité des personnels qui mettent en œuvre le programme d’éducation à la sexualité, EVAR à l’école primaire, est engagée : FAUX
#
Comme pour le reste des enseignements, les personnels au contraire doivent respecter les programmes et les mettre en œuvre. De nombreux textes successifs confirment l’obligation de cette éducation (loi n°2011-588 du 4 juillet 2001 de 2001, circulaire du 13 sept. 2018 et du 30 sept. 2022). Le code de l’éducation stipule qu’« une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire (…) ainsi que d'autres intervenants extérieurs (…)»
L’éducation à la sexualité n’est pas une nouveauté et n’a jamais été remise en question légalement malgré les nombreuses tentatives d'intimidation.