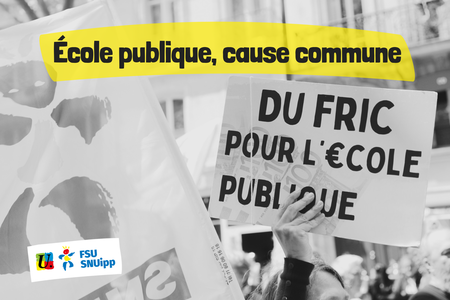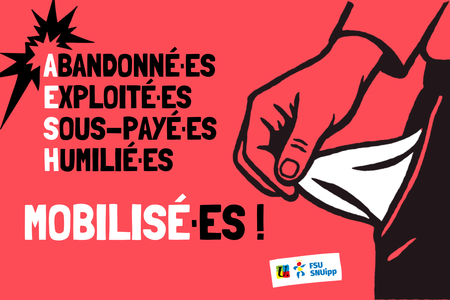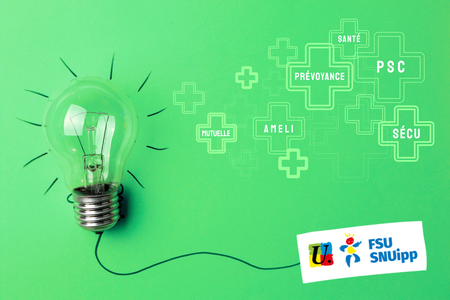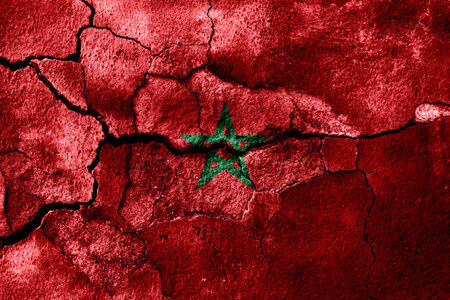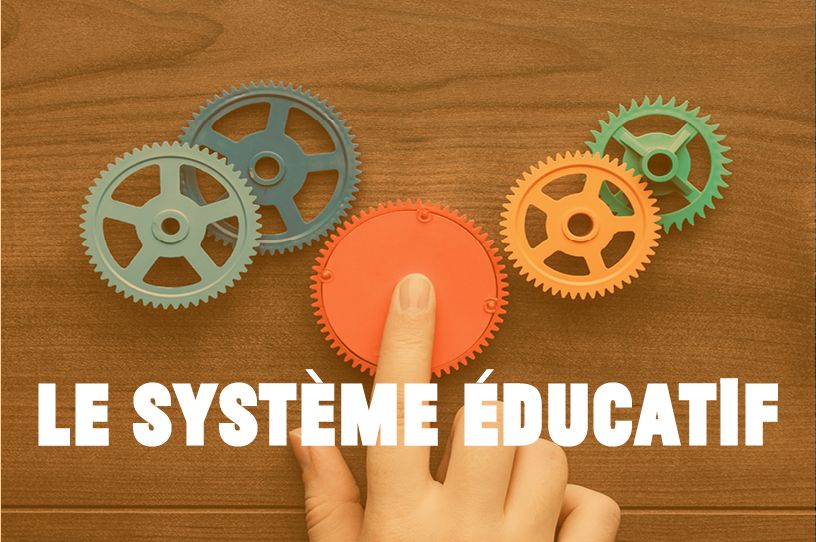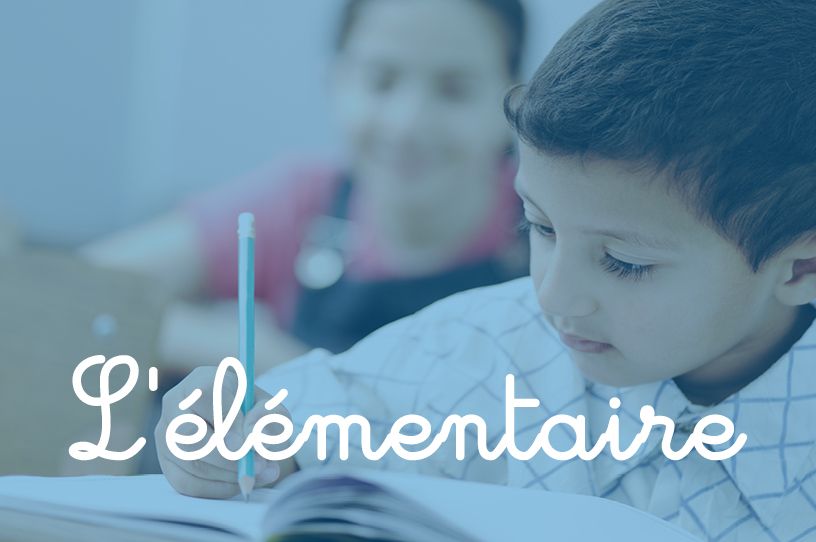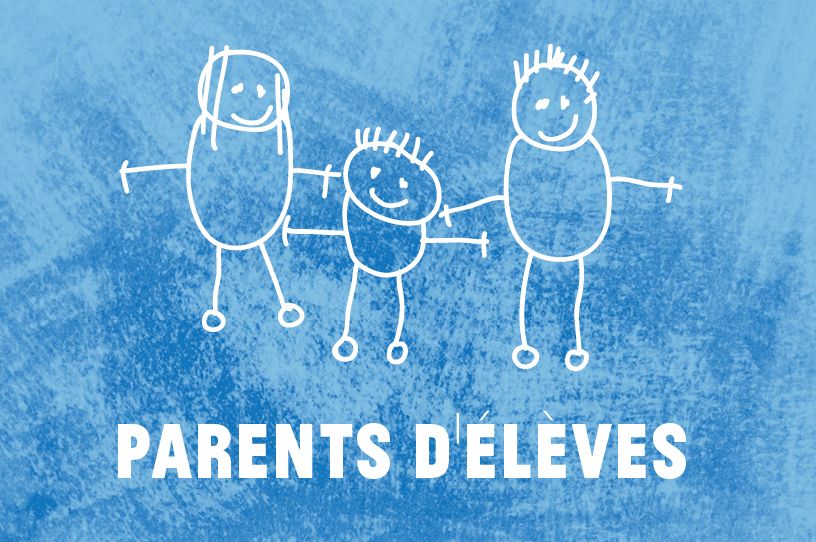“La dépense éducative est avant tout un investissement”
Mis à jour le 29.08.25
min de lecture
Interview de Julien Grenet, chercheur en économie et directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques.
DANS UN CONTEXTE DE RÉDUCTION BUDGÉTAIRE ET DE BAISSE DÉMOGRAPHIQUE, NE SERAIT-IL PAS LOGIQUE DE DIMINUER LES EFFECTIFS ENSEIGNANTS ?
Depuis 2010, nous assistons à une forte baisse de la natalité en France. Une chute considérable qui se répercute dans le système éducatif où les effectifs du premier degré ont déjà fondu de 8% depuis 2015. Durant cette période, le nombre d’enseignants ne s’est pas ajusté à la baisse des effectifs scolaires et, mécaniquement, la taille des classes a diminué dans le public.
Au cours des dix prochaines années, nous nous attendons à une baisse supplémentaire des effectifs d’élèves d’environ 19% dans le premier degré. Il pourrait être tentant de réduire le nombre d’enseignants pour maintenir la taille des classes en diminuant de 54 000 le nombre d’enseignants d’ici à 2034. Une économie à court et moyen terme qui représenterait environ 3,4 milliards d’euros par an à cet horizon.
QUELS EFFETS SI ON CHOISIT DE MAINTENIR LES EFFECTIFS ENSEIGNANTS ?
En maintenant les effectifs enseignants à leur niveau actuel dans le premier degré, nous pourrions obtenir une baisse très significative des effectifs par classe, qui passeraient de 22,4 élèves aujourd'hui à 18,2 en 2034, soit un niveau plus proche des standards européens. Une littérature scientifique bien établie montre l'efficacité de la réduction de la taille des classes pour les élèves, à court terme du point de vue des acquis scolaires mais aussi à long terme, à travers un taux d’emploi plus important et des salaires plus élevés.
Même en prenant la fourchette basse des effets bénéfiques, en 2034, une réduction de la taille des classes se traduirait par des gains salariaux futurs d’environ 4,5 milliards d’euros. Du fait de l’augmentation des salaires, il y aurait également un bénéfice pour les finances publiques avec des recettes fiscales augmentées de 2,9 milliards d’euros. Par ailleurs, ce calcul ne prend pas en compte d’autres bénéfices, liés notamment à l’amélioration des conditions de travail pour les enseignants. Au final, il s’avère que la réduction du nombre d’enseignants n’est pas une opération rentable sur le long terme, puisque pour 1 euro économisé sont perdus 9 euros pour la société.
COMMENT ASSURER L’ÉQUITÉ TERRITORIALE ?
L’étude propose de maintenir au niveau national le nombre d’enseignants à son niveau actuel, ce qui permettrait de réduire la taille des classes en éducation prioritaire à 12 élèves de la petite section au CM2 et de baisser harmonieusement la taille des classes dans les écoles hors éducation prioritaire. Dans certains territoires comme l’Ile-de-France, le pourtour méditerranéen ou la Loire-Atlantique, cela nécessiterait de recruter des enseignants et, à l’inverse, dans d’autres parties du territoire où la baisse démographique est très forte, comme dans l’Est de la France, de réduire le nombre d’enseignants avec le non remplacement des départs en retraite.
Assurer un taux d’encadrement plus élevé est aussi une façon d’améliorer l’attractivité du métier pour permettre les recrutements là où ils sont nécessaires. Il est aussi possible d’utiliser une partie de la baisse démographique pour revaloriser le salaire des enseignants, pour mieux les former ou pour mettre en place d’autres politiques comme par exemple le tutorat qui, à la lumière des travaux de recherche, apparaît comme l’un des dispositifs les plus efficaces pour lutter contre la difficulté scolaire.
"Assurer un taux d’encadrement plus élevé est aussi une façon d’améliorer l’attractivité du métier"
QU’EST-CE QUI JUSTIFIE QUE LA PUISSANCE PUBLIQUE PRENNE EN CHARGE LA DÉPENSE ÉDUCATIVE ?
La dépense éducative, lorsqu’on la compare à certaines politiques sociales ou fiscales, est avant tout un investissement et présente un meilleur « rendement » pour la puissance publique. Un constat qui est un peu trop souvent passé sous silence lors des arbitrages budgétaires. L’une des principales justifications de la dépense publique en éducation est d’assurer à tous les individus un accès équitable à cette ressource car si cette charge revenait aux familles, cela se traduirait par des inégalités considérables d’éducation qui ne feraient que renforcer les inégalités déjà observées sur le marché du travail. Ce serait aussi une perte de potentiel pour la nation.
Les bénéfices de l’éducation profitent aux individus mais aussi à la société à travers une amélioration de la santé, une baisse de la criminalité ou encore une augmentation de la participation civique. Des bénéfices qui sont moins facilement quantifiables mais indéniables. Pour toutes ces raisons, les dépenses éducatives devraient être sanctuarisées.