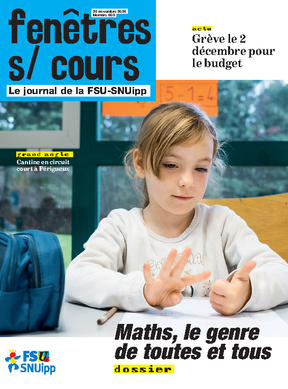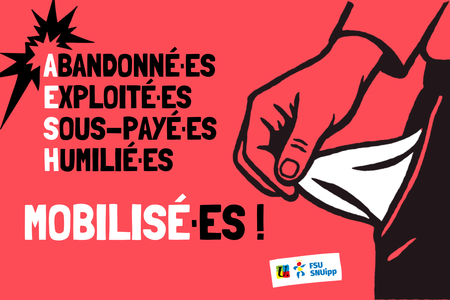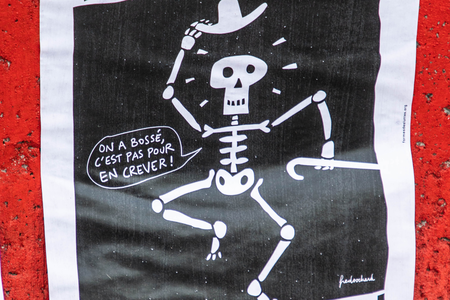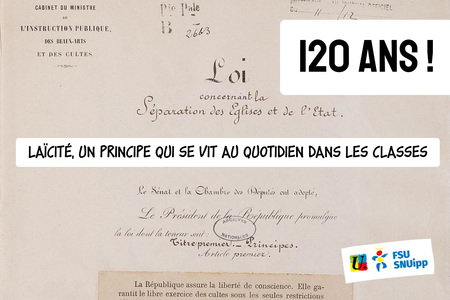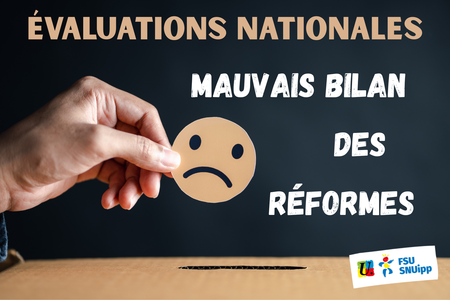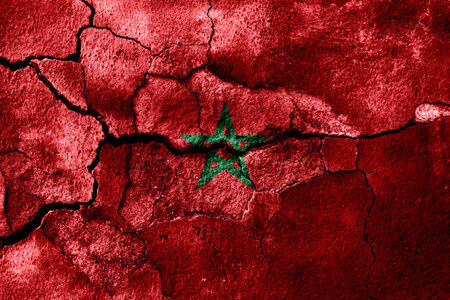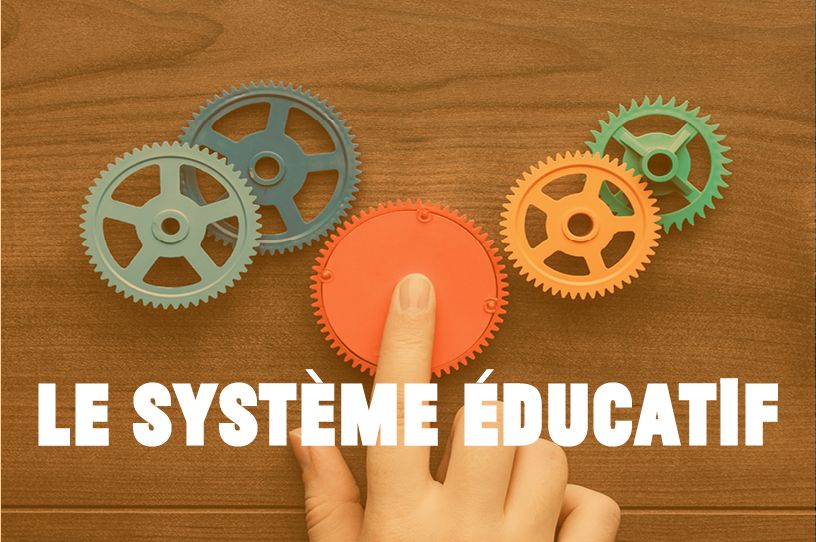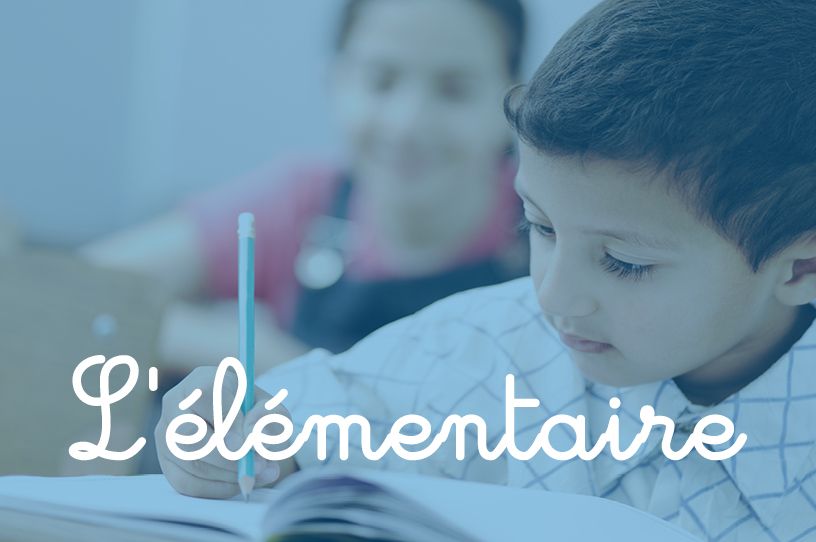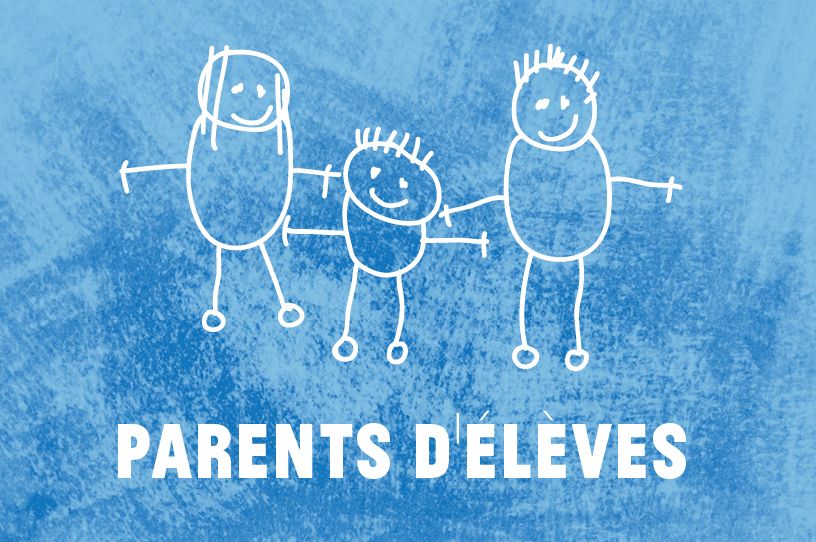Faites vos jeux !
Mis à jour le 29.08.25
min de lecture
Les nouveaux programmes de français et mathématiques qui remettent en question la place du jeu.
“ Au cycle 3, l’année est orientée par une perspective : « Découvrir – Jouer ». Celle-ci encourage et valorise le plaisir de la découverte et du jeu dans le processus d’apprentissage » peut-on lire dans les principes des nouveaux programmes. Et pourtant, la place du jeu à l’école semble perdre tout son sens. Alors que ce dernier avait réussi à faire sa place à l’école maternelle dans les programmes et en formation, les nouveaux textes Développement et structuration du langage oral et écrit et d’Acquisition des premiers outils mathématiques focalisent sur des formats scolaires précoces et font oublier le préambule des programmes de 2021 pourtant toujours d’actualité. Une minimisation réaffirmée en cycle 2 où le jeu, par exemple, n’est cité que pour « appliquer une règle » en guise de critère de réussite à la compréhension de texte. Où « jouer au jeu de 7 familles » permet de valider la capacité à catégoriser. Où les « jeux de rôles » montrent que les élèves « adaptent les registres de langues ».
En cycle 3, « la dimension artistique et créative des productions écrites est notamment valorisée afin d’encourager chez l’élève le développement de son imagination, le plaisir de jouer avec la langue, et la découverte de processus créatifs. » Mais en regardant de près, les « jeux de rôles improvisés ou préparés » ainsi que « le jeu théâtral » ne sont plus explicitement présents.
Il faudra attendre la 6e pour « se masquer, jouer, déjouer des ruses en action au théâtre. » En mathématiques, la place du jeu est proche du néant au cycle 2 et 3 et ne concerne presque que les domaines « géométrie » et « grandeurs et mesures ». Et au cycle 1, seuls « le jeu de l’oie et les petits chevaux » ont le vent en poupe, avec une légère allusion aux jeux de construction. Quid des jeux d’exploration, symboliques et à règles ?
DU « CONTRAT LUDIQUE » AU « CONTRAT DIDACTIQUE »
Le jeu a-t-il toujours sa place dans les apprentissages ? Les liens entre jeu et éducation agitent les esprits depuis l’Antiquité et n’ont de cesse d’évoluer. Éric Sanchez, professeur en technologies éducatives à l’université de Genève et auteur de « Enseigner et former avec le jeu », rapporte que de nombreuses études qui ont tenté de comparer les apprentissages en contexte de jeu avec ceux obtenus lors de situations d’apprentissage plus traditionnelles ne sont pas convaincantes. Concernant les études sur le lien entre jeu et motivation, elles sont contradictoires. Par ailleurs, il regrette que les études ne prennent pas en compte le rôle du PE, grand oublié des travaux de recherche sur ces questions. Pourtant, selon ses travaux « former avec le jeu permet de développer l’autonomie, la confiance et la créativité avec des pratiques innovantes ».
Mais toutes les pratiques du jeu ne se valent pas. Éric Sanchez définit le jeu comme adidactique et frivole et pense qu’il doit être reconnu comme tel pour que les élèves le vivent comme une expérience qui développera des connaissances. C’est le « contrat ludique », le « c’est pour de faux » qui permet de prendre plaisir à jouer, tester, se tromper, prendre des initiatives avec des conséquences minimisées grâce aux règles qui délimitent cet espace de liberté. Selon lui, il est donc important pour l’enseignant·e « d’introduire et d’orchestrer un univers narratif » identifiable comme jeu. À l’issue de la partie, une étape de verbalisation des émotions ressenties, mais aussi de verbalisation des stratégies, des obstacles rencontrés est essentielle. C’est le « débriefing ». Dans un cadre scolaire, le joueur apprend lorsqu’il quitte le jeu et qu’il réalise que les connaissances mobilisées peuvent être formalisées, institutionnalisées pour être transférées.
Cette phase de contrat didactique est particulièrement importante pour les élèves de milieux populaires. Selon le cadre général des documents d’accompagnement des programmes, les pauses réflexives sur les jeux sont pertinentes à partir de 5 ans. Avant cet âge, cette ressource préconise de permettre aux jeunes enfants de vivre le maximum d’expériences, qu’elles soient sensori-motrices ou langagières, notamment par les jeux libres, mais aussi d’exploration.
Interview de GILLES BROUGÈRE
Professeur émérite de sciences de l’éducation à l’université Sorbonne Paris Nord. Il a co-dirigé le « Dictionnaire des sciences du jeu » en 2024, Éd. Erès.

EN QUOI LE JEU EST-IL IMPORTANT EN MATERNELLE ?
Avant d’apprendre, il faut sans doute avoir envie d’apprendre, et le jeu, comme d’autres activités moins structurées telles que les activités d’exploration, permet de découvrir et invite à résoudre des problèmes. À l’opposé d’une conception scolaro-centrée, c’est le parti pris d’une vision qui pense la rupture progressive entre la famille et l’école. L’idée est de ne pas confronter directement l’enfant à un apprentissage structuré mais de lui permettre de découvrir progressivement ce qui fait l’intérêt d’une connaissance et donc de lui donner du temps pour explorer et jouer. Même si le jeu n’est pas une solution miracle, il permet de se sentir bien à l’école, d’apprivoiser ce nouvel espace social.
QUEL IMPACT SUR LES INÉGALITÉS SCOLAIRES ?
Aucune étude ne permet de démontrer son impact. L’idée reçue, selon laquelle il faudrait proposer plus d’activités scolaires aux enfants défavorisés pour compenser les inégalités, peut être contestée. Les enfants de milieux sociaux privilégiés explorent davantage en contexte non scolaire. Ne faudrait-il pas fournir à tous les enfants ces expériences par des situations qui ne sont pas formatées sur le modèle scolaire, garantissent un certain plaisir, s’appuient sur l’initiative de l’enfant ? Ces apprentissages informels sont nécessaires et continuent d’être complémentaires à l’école élémentaire, notamment par le biais des activités de loisirs.
QUELLE POSTURE POUR LES PE ?
L’enseignant ou l’enseignante doit aménager l’espace et le temps de manière à offrir la possibilité d’explorer. Une organisation qui doit s’adapter aux besoins évolutifs des enfants. Il est essentiel d’observer pour leur permettre d’aller plus loin que leur jeu routinier, chercher ainsi à les pousser à relever des défi s, les mettre en tension pour qu’ils aient envie de découvrir et d’évoluer en termes de langage. Cela suppose que les PE soient capables d’inciter et parfois de supporter des jeux sans jamais les diriger au risque de détourner le jeu en activité scolaire. Une posture que bon nombre de collègues peuvent adopter à condition que le cadre leur permette de libérer cette potentialité.